Combien de temps Jean Moulin aurait-il tenu sous l’œil des caméras intelligentes, des capteurs urbains, des fichiers croisés et des réseaux interconnectés de surveillance qui surplombent aujourd’hui nos rues comme nos vies digitales ? Si l’État pétainiste avait eu à sa disposition les outils technologiques dont on s’apprête à doter la police et désormais certaines mairies, la Résistance n’aurait tout simplement pas existé.
C’est dans ce contexte qu’a éclaté la dernière polémique autour des propos de Mathilde Panot (LFI) sur BFM TV (et largement relayés) qui a évoqué les projets de désarmement des polices municipales et de suppression de la vidéosurveillance, portés par son organisation politique. Sortie sans précaution et sans mise en contexte, la phrase de Mathilde Panot a eu le mérite de faire resurgir des débats fondamentaux sur la place de la police dans notre société, sur l’usage politique de la sécurité et sur la dérive technologique de l’appareil répressif. Elle questionne une évolution silencieuse mais persistante : la montée en puissance, élection après élection, d’une police municipale armée, aux compétences élargies, de plus en plus imbriquée dans une logique de surveillance généralisée et de répression, souvent déconnectée des besoins réels des habitants.
La gauche sommée de jurer fidélité au sécuritaire
Depuis, c’est la curée. Les cris d’orfraie n’ont pas tardé, à droite bien sûr, mais aussi à gauche. Et pourtant, le fond du propos mérite mieux que des caricatures ou des règlements de compte. Ce qui frappe, ce n’est pas la proposition de LFI, traditionnelle dans une certaine gauche radicale, ni les réactions qu’elle a suscité dans les rangs de la droite et de l’extrême droite, mais la panique qu’elle provoque dans le reste de la gauche. Fabien Roussel comme Olivier Faure se sont immédiatement étranglés d’indignation, incapables d’imaginer une politique de sécurité qui ne soit pas calquée sur les standards de la droite : plus de caméras, plus d’uniformes, plus d’armes, plus de fichiers. Leur leitmotiv, c’est « plus de moyens », tout en renonçant à interroger la nature de la police, son rôle, sa composition, ses missions.
Une incapacité qui commence par le refus de poser clairement la question du racisme systémique qui sévit au sein des forces de l’ordre. Impossible d’obtenir d’eux que ces pratiques discriminatoires et ces brutalités ciblées puissent être seulement mentionnées. Pourtant de multiples rapports – Défenseur des droits, CNCDH, observatoires indépendants – l’ont documenté : les contrôles au faciès sont massifs, les violences policières touchent de manière disproportionnée les jeunes hommes racisés des quartiers populaires. Et les mécanismes internes de sanction sont quasi inexistants. Deux ans après le meurtre de Nahel, les syndicats de police peuvent continuer à se dire « en guerre contre des hordes sauvages et des nuisibles » et la gauche regarde pour l’essentiel ailleurs.
Au mieux, elle parle du besoin de police de proximité, ou abstraitement de son souhait d’une police « républicaine », tout en faisant mine d’ignorer qu’une partie de la population vit les forces de l’ordre, non comme un recours, mais comme une menace. Et la répression ne se limite pas aux seuls quartiers populaires. Elle s’est abattue avec brutalité sur toutes les formes de contestation sociale. Les mobilisations écologistes dans les ZAD, les cortèges des Gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites ou contre les violences policières elles-mêmes, ont été systématiquement la cible de brutalités policières. Grenades mutilantes, tirs de LBD, nasses, gardes à vue arbitraires : le répertoire d’action de la police dans les manifestations s’est durci à un niveau inédit sous la Ve République, en particulier depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron et le sinistre 1er mai 2018. Cette dérive autoritaire s’inscrit dans une doctrine de maintien de l’ordre tournée contre les mouvements sociaux, et dans laquelle les polices municipales pourrait être appelée à jouer un rôle croissant si ses prérogatives continuaient de s’étendre.
Dans les villes dirigées par la droite ou l’extrême droite, la police municipale devient souvent un instrument de contrôle social au service de trajectoires personnelles et d’une idéologie sécuritaire et autoritaire. À Béziers, Fréjus, Orange ou Perpignan, les maires ont multiplié les arrêtés ciblant les populations les plus précaires – jeunes, Roms, migrants. Toute politique de prévention a été passée par dessus bord, au profit d’une « robocopisation » des unités déployées. À Nice, Christian Estrosi a transformé sa ville en laboratoire de vidéosurveillance algorithmique, avec des dispositifs de reconnaissance faciale testés dès 2019. Dans ces communes, la police municipale dépasse largement les fonctions de proximité : elle devient le bras armé d’un projet politique réactionnaire, où l’ordre public justifie toutes les restrictions aux libertés individuelles.
La question du transfert progressif de responsabilités régaliennes de l’État vers les communes, reste la dernière dimension du débat sécuritaire où les élus de gauche acceptent encore de s’aventurer. Les projets de loi récents, sous couvert de « boîte à outils » pour les maires, visent en réalité à déléguer aux collectivités locales des tâches qui relevaient autrefois de l’État – maintien de l’ordre, surveillance, gestion des conflits de voisinage… Or, cette décentralisation sécuritaire intervient dans un contexte d’austérité budgétaire chronique. Les communes doivent assumer ces nouvelles missions sans que les moyens suivent. Entre 2017 et 2023, la part du budget des communes consacrée au financement de leurs polices municipales a bondi de 33%. Des « moyens » qui seront par définition ôtés aux politiques conduites dans d’autres domaines, culturel, social ou encore éducatif.
Ce transfert est donc à la fois une externalisation de la responsabilité politique et un piège financier. Il accentue les inégalités territoriales, certaines communes riches pouvant déployer des dispositifs sécuritaires sophistiqués, pendant que d’autres renoncent à la prévention faute de budget. Pire, comme la Cour des comptes le souligne elle-même, l’intensification des moyens de police municipale dans une ville conduit bien souvent « la Nationale » à réduire les siens dans le secteur. Le résultat est prévisible : une police de riches dans les villes aux populations aisées, et une pauvre police ailleurs.
Des outils inopérants, coûteux, et de plus en plus massifs
Autre question sur laquelle la gauche est trop souvent muette : le déploiement de technologies de surveillance. En 2023, la France comptait plus de 90 000 caméras de vidéosurveillance sur la voie publique, contre 60 000 en 2013. Ces dispositions dont désormais déployés dans 95 % des communes de 10 000 à 100 000 habitants. Parallèlement, l’État a généralisé les caméras-piétons individuelles : environ 54 000 caméras corporelles sont désormais distribuées aux policiers et gendarmes, avec comme objectif, et au-delà de la transparence, collecte de preuves lors des interactions police-population. Police et gendarmerie françaises opèrent également une flotte de plus d’un millier des drones de surveillance aériens.
Pourtant, on est en droit de s’interroger sur les résultats obtenus par ces dispositifs. Ainsi, la Cour des compte, les statistiques de la gendarmerie nationale et la plupart des études s’accordent pour affirmer que seule une infime partie des enquêtes — 1 à 2 % — sont résolues grâce à ces coûteuses caméras de vidéosurveillance. Et aucun effet significatif de dissuasion n’a été mesuré sur la délinquance qui n’est au mieux que « déplacée ». Face à l’efficacité très relative de ces réseaux de caméras, tant sur le plan de la dissuasion que de l’élucidation, notamment en raison du manque d’agents pour « regarder » ou « exploiter » ces images, leurs promoteurs réclament désormais que ces dispositifs soient couplés à l’intelligence artificielle. Ainsi depuis 2023, des caméras « intelligentes », dotées d’algorithmes de détection de comportement, ont été autorisées à titre expérimental dans le cadre des Jeux Olympiques.
La CNIL et de nombreux chercheurs alertent pourtant sur le risque d’une surveillance de masse qui s’intensifie tant quantitativement (plus de caméras, plus de capteurs) que qualitativement (technologies plus intrusives et algorithmes d’automatisation). En effet, dotés d’une quantité « d’attention » quasi illimitée en raison de la progression de la seule puissance de calcul, le couplage des capteurs à des agents de surveillance numériques – c’est-à-dire des logiciels de détection automatique de comportements, dessine les contours d’une dystopie d’autant plus terrifiante qu’elle pourrait compter sur le bienveillant concours des géants américains de l’industrie de l’attention qui disposent déjà d’un très large accès à nos vies numériques (géolocalisation, données…).
Côté armement, c’est la même logique. En 2010, moins de 40 % des policiers municipaux étaient armés. En 2025, ils sont 60 %. Certaines communes frôlent les 90 %. Et l’on ne parle pas que de matraques ou de gaz. Taser, LBD, armes à feu : dans des centaines de villes, des agents de proximité portent les mêmes armes que les policiers nationaux, sans la même formation. Depuis 2017, la loi leur donne quasiment les mêmes droits d’usage des armes à feu. Le projet de loi Buffet prévoit même de leur confier des missions de police judiciaire, comme des fouilles de véhicules ou des contrôles renforcés.
Sur tous ces sujets, la gauche est prise dans la « rayon paralysant » du discours dominant. Puisque la moindre remise en question de ces tendances est perçue comme une insulte au « bon sens » sécuritaire, elle se contente d’accompagner ce mouvement plutôt que de l’interroger et de le remettre en cause. Dans l’indifférence quasi générale, l’extrême-droite désormais aux portes du pouvoir, va donc pouvoir compter sur des outils de surveillance et de répression sur lesquels ses sinistres prédécesseurs n’auront jamais pu compter.
Une police à reconstruire, pas à dupliquer
Soyons clairs : si le débat a été en partie instrumentalisé à gauche, c’est que l’enjeu réel n’était pas tant les caméras ou les pistolets que la préparation des municipales de 2026. La déclaration abrupte de Mathilde Panot survient opportunément après une série de prises de distance ostentatoires de la France Insoumise et de refus de listes communes rassembleuses à gauche. Et les réponses outrées au PS et au PCF visaient elles aussi, non pas à protéger les habitants, mais à fortifier les clivages internes à gauche et en particulier avec LFI, souvent artificiels. Résultat : au lieu d’un débat démocratique sur la sécurité, nous avons droit à un règlement de comptes à OK Corral, sur fond de guerre d’appareils et de petites ambitions électorales.
Or, si nous voulons véritablement freiner puis inverser la course folle au « tout sécuritaire », nous devons construire avec la population une alternative claire et crédible. Cela passe par une grande opération de vérité : sur le coût réel, sur l’efficacité réelle, sur les dérives constatées et les risques qu’elles font peser sur nos libertés. Cela passe par la repolitisation de la question de la sécurité, non plus comme affaire de police, mais comme enjeu d’égalité, de droits et de justice sociale.
La gauche doit bien-sûr affirmer comme elle le fait encore que la sécurité véritable ne peut être dissociée de la justice sociale. Là où l’école, le logement, l’accès aux droits reculent, c’est le répressif qui avance. Mais la gauche doit aussi et urgemment répondre à cette question : quel modèle de police voulons-nous ? Oui, il faut sortir du tout répressif bâti autour du consensus de la peur. Oui, il ne suffira pas de désarmer une police municipale ou de supprimer les caméras. Oui, il faut évaluer sérieusement l’efficacité réelle de ces politiques. Oui, il faut ouvrir un débat démocratique, localement, avec la population, sur les priorités, les besoins, les moyens. Cela suppose du temps, de l’écoute, une démarche de reconquête de la confiance populaire. Cela suppose surtout de redéfinir les missions mêmes des polices, nationales et municipales. Cela suppose aussi une police formée, une police qui ne répond pas par la peur à l’angoisse des populations, et enfin une police qui ressemble à la population qu’elle est censée protéger, elle qui est le plus souvent blanche dans des quartiers racisés, masculine quand il s’agit d’entendre la détresse d’une femme victime de violences sexuelles et sexistes, et autoritaire dans des contextes qui exigeraient dialogue et médiation.
On ne réglera rien en renforçant ce modèle-là. Les classes populaires, fussent-elles des tours ou des bourgs n’ont rien à y gagner. La gauche doit enfin s’atteler à ce chantier d’une police républicaine unifiée, nationale, avec des moyens et des critères clairs ; une police débarrassée de ses réflexes racistes ; une police qui ne soit pas l’instrument de la perpétuation d’un ordre fondamentalement injuste.
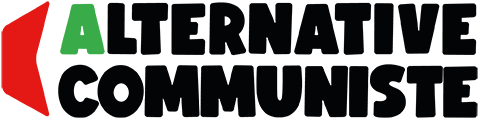
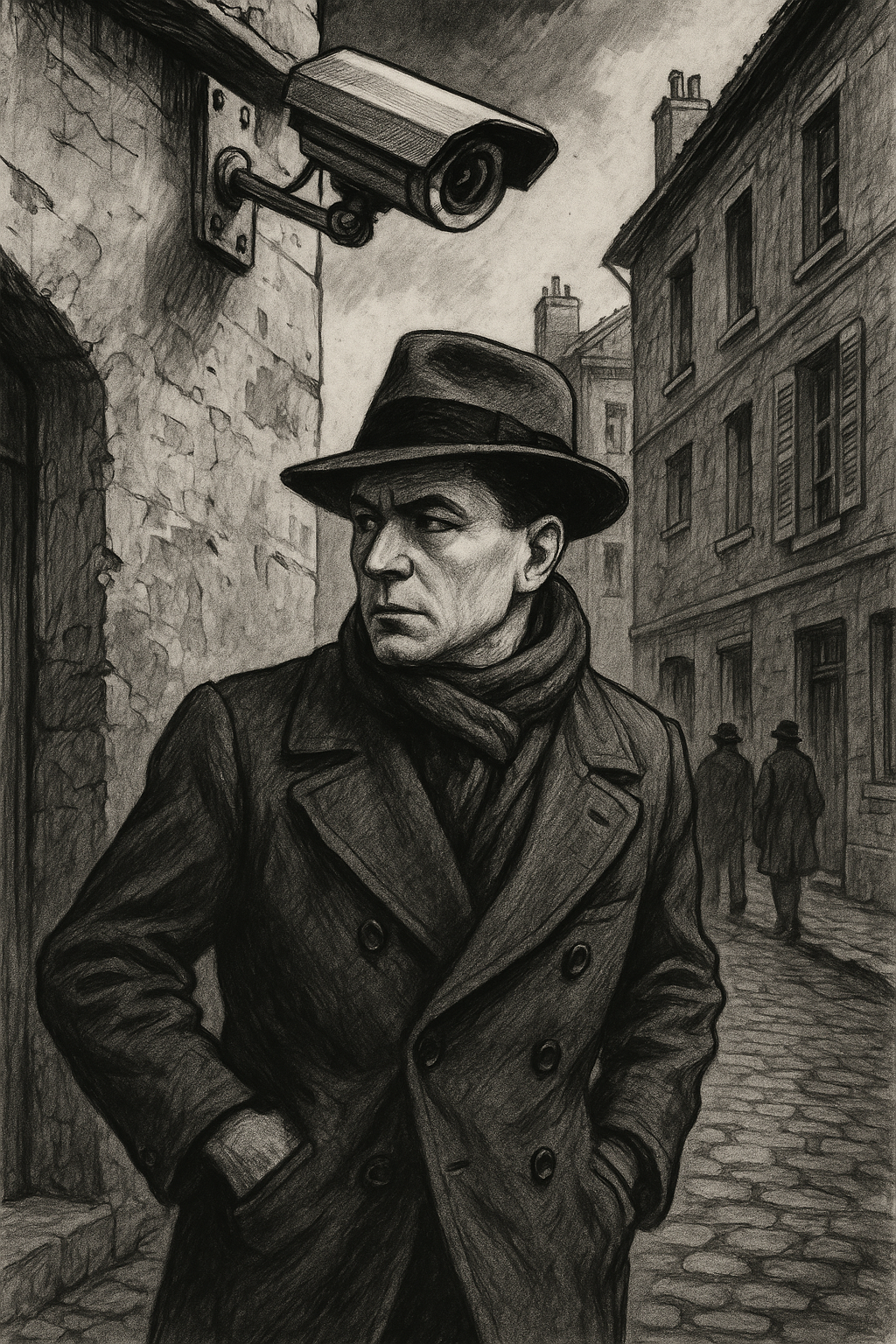


Laisser un commentaire