J’ai écrit deux textes portant sur la question de la « dissuasion » nucléaire. Je mets « dissuasion » entre guillemets pour marquer en quelle dérision je tiens ce terme.
Mon premier texte, daté du 17 juin 2023, était intitulé « le PCF devrait exiger le démantèlement de la force de dissuasion nucléaire française ». Il était suivi d’une note : « Mise au point sur : le PCF et la force nucléaire française ». Mon deuxième texte, daté du 8 mars 2025, avait pour titre : « La bombe nucléaire est un outil de suicide collectif ». Deux ans après le premier, ce n’était plus au seul PCF que je m’adressais mais à l’ensemble des gauches. Tou.tes leurs dirigean.tes continuent à biaiser sur cette question de la « dissuasion » nucléaire et s’en tiennent à demander un « désarmement multilatéral, global et négocié ». Cette position est devenue intenable. Je suis convaincu que la seule position radicale et crédible est de se déclarer, ici et maintenant, pour « l’abolition inconditionnelle et unilatérale de la force nucléaire française. »
Retour sur le PCF et la « dissuasion » nucléaire
Récemment je suis tombé sur un article que Jacques Fath, qui fut de 2006 à 2013 responsable des Relations internationales du PCF, avait publié en 2018 dans le numéro 39 de Contretemps-revue de critique communiste. Son article portait sur « Le rapport Kanapa ». Bien qu’il soit long je le reproduis ci-dessous car il est essentiel pour comprendre comment le PCF avait pris brutalement fait et cause en 1977 pour la « dissuasion nucléaire ». C’est un épisode que j’évoque en les termes qui suivent dans la présentation orale de mon livre « Tout ça…Pour ça ? » (Cap Béar, avril 2023) :
« Les législatives fixées au mois de mars 1978 se rapprochaient. Comme prévu, l’actualisation du programme commun avait démarré. Les négociations s’étaient ouvertes le 31 mai 77. Le PCF voulait élargir le champ des nationalisations alors que le PS n’en voulait pas. A ma grande stupeur, un autre point d’achoppement avait brusquement surgi, cette fois du fait du PCF. Il avait demandé que le maintien de la force de frappe nucléaire soit stipulé dans le programme. Alors qu’il avait toujours été contre l’arme nucléaire, il venait brusquement de changer de doctrine. En effet, le 11 mai 1977, le Comité central s’était prononcé pour le maintien de l’arme nucléaire, sans que absolument rien ne le laissa prévoir. l’Humanité du lendemain avait publié le rapport de Jean Kanapa Pour l’indépendance et la souveraineté de la France, mais la discussion qui s’en était suivie ne l’avait pas été. Pour en savoir plus, il avait fallu attendre 2007 avec la publication des premiers travaux de chercheurs portant sur les archives du PCF. Une partie de ce travail avait consisté à dépouiller les documents écrits et sonores des réunions du CC de 1921 à 1977. Des fiches synthétiques avaient été publiées, dont une correspondant à la réunion du 11 mai 1977. On y lisait que Georges Marchais avait argué du « nécessaire pragmatisme » qui devait prévaloir dans le changement de position. Il fallait comprendre que la direction du parti, dans la perspective de l’accession au pouvoir de la gauche en 1978 ne voulait pas que l’on puisse douter, compte tenu de ses liens privilégiés avec l’URSS, de son attachement à une défense nationale indépendante tous azimuts et une politique étrangère souveraine. F. Mitterrand avait refusé que le maintien de la force de frappe soit retenu dans le texte du programme et avait proposé que la question soit soumise à un référendum. Ce fut un clash. Le 21 septembre 1977, les négociations s’étaient achevées sur un constat d’échec. »
Sur le « Rapport Kanapa »…
Jacques Fath – 28.08.2018
Jacques Fath, est un ancien adhérent du PCF. Il fut membre du Comité exécutif et responsable des Relations internationales de ce parti de 2006 à 2013. Il est l’auteur de « Penser l’après. Essai sur la guerre, la sécurité internationale, la puissance et la paix dans le nouvel état du monde », Éditions Arcane 17, 2015.Dans la décennie 70, l’aspiration à une politique d’indépendance nationale rallie une forte majorité du peuple français. Signé en 1972, le Programme commun de la Gauche, traduit, en particulier dans les domaines de l’ international et de la défense, cet attachement populaire issu d’une longue histoire, y compris celle liée à la deuxième Guerre mondiale et à la Résistance.
Cette situation inquiète les alliés occidentaux de la France. Ce qui les indispose, cependant, c’est moins la rémanence gaulliste que le risque nouveau d’une France susceptible de s’inscrire dans une contradiction vis à vis du bloc des puissances occidentales : une France gouvernée par la gauche. Celle-ci s’y prépare, et ce qui domine alors c’est un discours largement antinomique avec la stratégie américaine et otanienne.
Dans cette période, la question montante n’est plus de savoir si la France doit « continuer » l’héritage gaullien, malgré la prégnance de celui-ci, mais si elle doit s’engager plus avant (ou non) dans une intégration libérale européenne et une solidarité atlantiste, aux côtés des États-Unis. Avec Valéry Giscard d’Estaing (VGE), des pas significatifs ont déjà été effectués dans cette voie, en particulier avec le renforcement de la concertation des principales puissances dites industrialisées, principalement occidentales ([1]). Sur ces enjeux, le Parti socialiste et le Parti communiste français se divisent. « L’actualisation » du Programme commun n’y résiste pas. A moins que ce soit alors le moment d’une « convergence » tacite objective sur l’opportunité d’une rupture…
En mai 1977, Jean Kanapa présente au Comité central du PCF un rapport intitulé « La politique de défense nationale et l’action pour l’indépendance, la paix et le désarmement » ([2]). Ce rapport, désormais désigné « Rapport Kanapa », rappelle l’engagement du PCF contre la guerre, contre la course aux armements, pour la paix et le désarmement, pour l’internationalisme, contre les guerres coloniales. Il dénonce le rôle de l’OTAN, la stratégie nucléaire du pouvoir giscardien… L’ensemble des options traditionnelles du PCF sur les questions de la paix et du désarmement figurent en tête du rapport et son réitérées. C’est ce qu’on appelle un texte « bien bordé ». La logique politique d’ensemble, cependant, n’a rien de traditionnelle. C’est un bouleversement doctrinal et politique majeur pour un parti historiquement né du refus de la guerre, en 1920. Pour beaucoup de Communistes, ce fut un choc. Plus de 40 ans après il est utile d’y revenir afin de comprendre les raisons d’un choix aux incidences considérables, immédiates et de longue durée.
Le Rapport Kanapa réaffirme « l’exigence absolue » de l’indépendance française comme condition du succès des réformes démocratiques du Programme commun, et pour pouvoir s’opposer à toute « ingérence, pression ou représailles extérieures ». Pour répondre à cette exigence, il soulève « le problème de l’arme nucléaire ». L’objet paraît clair : le retard considérable, en qualité et en quantité, à l’équipement des forces conventionnelles oblige à considérer l’armement nucléaire comme « le seul moyen de dissuasion réel dont disposera pour un temps le pays pour faire face à une menace d’agression ». En conséquence, le rapport souligne : « Nous nous prononçons strictement – dans l’état actuel de la défense nationale et étant donné l’absence d’un système de sécurité collective en Europe – pour la maintenance de l’arme nucléaire, c’est à dire pour le maintien de l’aptitude opérationnelle de l’arme nucléaire (ce qui implique son entretien et l’inclusion des progrès scientifiques et techniques) au niveau quantitatif défini par les seules exigences de la sécurité et de l’indépendance du pays ». Ici, tous les mots sont importants. Le Rapport Kanapa se veut précis et cherche à couvrir l’ensemble des enjeux. L’option ainsi exposée est d’une grande importance. Ce qui est proposé soulève une série de questions touchant à la logique d’une nouvelle politique de défense nationale, à ses implications et conséquences politiques, à sa signification pour les orientations et l’identité politique même du PCF.
La dissuasion comme doctrine devenue acceptable
Pour Kanapa « la doctrine militaire deviendra une stratégie de dissuasion au sens strict ». Dans une forte critique de la politique giscardienne, il note que « la stratégie de la dissuasion nucléaire a fait place la stratégie de l’emploi. A la doctrine de défense tous azimuts a été substituée la doctrine de la bataille de l’avant, aux côtés de la Bundeswehr, contre les pays socialistes désignés comme le seul adversaire potentiel ». Le jugement porté ainsi comporte quelques raccourcis : ni le Livre blanc de 1972, ni la Loi de programmation militaire adoptée en mai 1976 (citée dans le rapport), n’ont « remplacé » la dissuasion par une « stratégie de l’emploi ». La stratégie de la France se situe explicitement dans une définition classique de la doctrine de dissuasion. Manifestement, pour faire admettre le principe de la dissuasion il devenait nécessaire, pour le PCF, de caractériser autrement la stratégie giscardienne… Au risque de tordre un peu le bâton de la réalité afin de faire apparaître la doctrine de dissuasion comme une option acceptable.
Bien sûr, on ne se situe plus, alors, dans la conception d’une défense « tous azimuts » comme l’entendait le Général de Gaulle. Et la conception de la bataille de l’avant vise à rendre possible un engagement militaire direct des forces françaises à l’Est, dans le cadre d’opérations alliées, avant même que le territoire français ne soit directement menacé. Valéry Giscard d’Estaing est effectivement plus favorable à une utilité (supposée) des armes nucléaires tactiques, comme armes d’emploi sur un champ de bataille, contre l’adversaire désigné : l’URSS et le Pacte de Varsovie. A l’époque, soulignons-le, l’arme nucléaire tactique est le missile mobile Pluton d’une portée maximale de 120 km et disposant d’une charge variable de 10 ou 20 Kilotonnes, c’est à dire à peu près équivalente ou bien nettement supérieure à la bombe larguée en 1945 sur Hiroshima…
On touche ici au problème lancinant et très sérieux des armes nucléaires tactiques, baptisées aujourd’hui, en France, « pré-stratégiques ». Leur emploi ne peut que signifier un échec de la dissuasion et l’entrée dans une guerre nucléaire. Leur fonction se situe, de facto, hors dissuasion ([3]). Pourtant, le Rapport Kanapa se contente alors d’une opposition au transfert des missiles Pluton hors du territoire national. Pourquoi ne pas exiger spécifiquement l’élimination de ces armes du fait du danger crucial et très particulier qu’elles représentent comme armes d’emploi, donc comme armes ne s’inscrivant nullement dans ce que Kanapa désigne lui-même, et entérine dans son rapport, comme une stratégie nécessaire de dissuasion au sens strict ?
Le Rapport Kanapa s’inscrit dans la dissuasion comme nouvelle doctrine présentée comme choix positif. Mais la dissuasion, c’est à la fois, indissociablement, le non-emploi et la menace d’emploi de l’arme nucléaire. Sans cette menace, il n’y a pas de dissuasion. Celle-ci n’empêche la guerre que par défaut. Elle n’est – si l’on peut dire – que le « mode de gestion » obligé d’une arme inutilisable… sauf à accepter rien moins que la possibilité du déclenchement d’une guerre nucléaire et d’une destruction de l’humanité. Comment peut-on – même en 1977 – non seulement accepter le principe de la dissuasion, les risques stratégiques qui vont avec, et les accidents toujours possibles (on le savait bien à l’époque), mais, en plus, assumer l’existence opérationnelle d’une arme considérée comme une « artillerie nucléaire » utilisable dans des batailles de chars ou sur des concentrations de troupes ? A l’évidence, malgré les tragédies d’Hiroshima et de Nagasaki, le débat politique français sur le nucléaire militaire est alors loin d’avoir intégré la dimension éthique et civilisationnelle du problème de l’existence des armes nucléaires… même au sein de la direction du PCF qui écarte la question. En ralliant la dissuasion nucléaire, le Rapport Kanapa va affaiblir la légitimité de l’action pour la paix en France.
Un pari ou une illusion sur les coûts
Le Rapport Kanapa suscite aussi des interrogations sur la crédibilité politique de l’option proposée, fondée sur une « maintenance de l’arme nucléaire », et pour une durée forcément indéterminée. La question des coûts de cette maintenance est posée. C’est la question du budget défense que le PCF tient à ne pas augmenter. Avec la préoccupation d’assurer la crédibilité de l’option de la maintenance, Kanapa indique que celle-ci comporte les charges de l’entretien, ainsi que l’inclusion des progrès scientifiques et techniques. Il souligne qu’une véritable indépendance de la force nucléaire nécessite un système indépendant de détection, et un autre système indépendant de repérage pour la marine. Cela implique aussi « la construction d’avions radar de surveillance (utilisés seulement en cas de crise) et la mise sur orbite de trois satellites destinés à l’observation, à la localisation et à la transmission ». Ces précisions sont très logiques car une maintenance crédible (ou un « maintien en état » dira-t-on aussi), exige, y compris dans un contexte de puissances en rivalités, un niveau de fiabilité, et de sécurité et d’efficacité adapté en permanence. Cela correspond cependant à des choix d’équipements de défense technologiquement sophistiqués aux coûts élevés. Ce qui signifie concrètement une « modernisation » régulière, donc un développement permanent du système d’armement nucléaire. C’est à dire une maintenance…durable.
Cela permet-il d’affirmer, comme le fait Kanapa, que la maintenance du nucléaire « ne se traduirait pas par un gonflement du budget militaire » ? La question est sensible. Elle se pose au point où Paul Laurent, lors d’une réunion du Bureau Politique fin avril 1977, suggère prudemment « d’être moins explicite sur le niveau de la maintenance » ([4]). En vérité, il est alors difficile de savoir précisément à l’avance le coût (forcément élevé) d’une telle politique. Même si on sait alors, par exemple, que les AWACS (avion radar de surveillance/détection/commandement produit par Boeing) mis en service en 1977, avaient un coût unitaire d’environ 270 millions de dollars. La France en a acquis 4, livrés en 1990-1991.
L’Atlantisme, défi de politique intérieure immédiat
Du Rapport Kanapa ressort une contradiction entre l’exigence d’indépendance vis à vis des blocs militaires, et l’acceptation d’une France membre de l’Alliance atlantique. Kanapa veut montrer qu’il n’évacue pas les problèmes. Il prend donc soin de rappeler l’appartenance de la France à l’OTAN. « Comme on le sait – écrit-il – le Programme commun prévoit que la France restera membre de l’Alliance atlantique, conformément aux termes du Traité qu’elle a contresigné le 4 avril 1949 et qui constitue au sens strict un engagement d’assistance mutuelle en cas de menace ou de pression extérieure sur l’une des parties ». A aucun moment Kanapa ne met en cause cet engagement d’assistance mutuelle, pièce maîtresse du Traité de l’Atlantique Nord. Certes, la France n’est plus membre de l’organisation militaire de l’Alliance, son Commandement intégré, depuis 1966. Et le rapport insiste sur ce qui doit caractériser un nouveau rôle français : détente, coexistence pacifique, initiatives pour la cessation de la course aux armements, désarmement, application de l’Acte final d’Helsinki, interdiction de la prolifération, participation à la Conférence de Vienne sur la réduction des forces et des armements en Europe centrale, conclusion du Traité de non-agression… Tout ceci constitue des engagements positifs… mais des questions se posent sur le plan politique.
Le rapport à l’Alliance atlantique oppose le PS et le PCF. Le PS a signé le Programme commun, et en vertu de son application, « le gouvernement se prononcera pour la dissolution simultanée du Traité de l’Atlantique Nord et du Traité de Varsovie ». Mais François Mitterrand voit les choses tout autrement. Il est et il restera favorable à l’Alliance et à un cadre euro-atlantique. Il estime, dans le même esprit, ne pas pouvoir être candidat à la présidence de la République sans être favorable à la dissuasion nucléaire. Dans son livre « Les mondes de François Mitterrand » ([5]) Hubert Védrine note que « François Mitterrand a eu besoin de tout son talent pour amener le PS, contre des oppositions internes pacifistes et antimilitaristes, à se rallier en 1978 à la stratégie de dissuasion nucléaire »… Un autre climat international est alors en train de se dessiner. Malgré la détente et les Accords d’Helsinki (1975), l’URSS se voit de plus en plus considérée comme une menace. En 1977, on est pas loin d’une crise Est/Ouest (1979 et l’Afghanistan) et d’une très forte montée des tensions. Une guerre idéologique a commencé.
Ce contexte de divergence affaiblit sérieusement l’option d’une doctrine nucléaire de dissuasion « tous azimuts » avancée dans le Rapport Kanapa. Dans la décennie 70, le paysage stratégique mondial, en dépit de la détente, reste structuré sur les rivalités de puissance et la logique des blocs. Ce concept de « dissuasion tous azimuts » né de la vision gaullienne de la France comme puissance de statut et de rôle particulier entre Washington et Moscou, est-il alors encore crédible ? Il faut évidemment en douter… Le Rapport Kanapa est en soi une reconnaissance de cette difficulté puisqu’il vise, précisément, dans le champ politique français, à dépasser cette contradiction entre le PCF avec son ambition gouvernementale, et un cadre stratégique existant, devenu dominant, de solidarité euro-atlantique. Le Rapport Kanapa a pour ambition de « moderniser » le PCF, de lui enlever son image pro-soviétique, de montrer sa « disponibilité » pour lui permettre d’exister et d’avancer dans un cadre politique et stratégique qui ne lui est pas favorable, et dans un rapport de force intérieur devenant pour lui compliqué. Mais l’idée de se rallier à la force de dissuasion afin de pouvoir affirmer son indépendance vis à vis de Moscou ne fonctionnera pas. Et dans un contexte de tensions qui s’exacerbent à gauche, l’échec de l’actualisation du Programme commun sur ces questions n’est certainement pas un hasard.
Le nucléaire militaire…nécessairement anti-démocratique
Enfin, le Rapport Kanapa soulève un problème de nature institutionnelle sur la démocratie. A juste titre, il affirme que « la décision d’emploi de l’arme nucléaire ne peut être laissée à un seul homme – le Président de la République ». Le Rapport propose donc la mise en place d’un Haut Comité Spécial comprenant, à côté du Président, le Premier ministre, le Ministre de la défense, les ministres « représentant la coalition gouvernementale » et le Chef d’État-major. Sa composition élargit le champ formel dans lequel doit se prendre la décision. Mais cela ne change pas grand chose. La proposition ne résout en rien le problème posé, c’est à dire l’hyper-centralisation sur le pouvoir exécutif, la mise à l’écart du Parlement, la confidentialité ou le secret des délibérations… c’est à dire l’absence de démocratie consubstantielle à la dissuasion nucléaire. Celle-ci implique d’ailleurs, dans des circonstances extrêmes, l’éventualité de décisions majeures immédiates inaccessibles par délibération. Le nucléaire militaire est, en soi, nécessairement anti-démocratique.
Pour le PCF, faire d’une maintenance de la force de frappe nucléaire, après le 22ème Congrès de février 1976 axé, précisément, sur l’exigence démocratique, est un peu contradictoire… D’autant que Jean Kanapa lui-même joua un rôle majeur dans la préparation et la tenue de ce congrès de forte signification dans l’histoire du parti.
Accepter une France puissance atomique ?
Les constats qui précèdent montrent qu’on ne peut accepter le projet politique d’une France, puissance atomique, sans conséquences, et sans que de fortes questions ne se posent avec insistance. Une première remarque s’impose : on ne dispose pas du nucléaire militaire comme s’il s’agissait d’un problème strictement national et de dimension… « technique ». Kanapa, manifestement, l’avait bien compris, qui multiplia les garde-fous et les précautions pour donner de la crédibilité et de la pertinence stratégique à un choix qui fut pourtant d’abord politique.
Le nucléaire militaire, en effet, ce n’est pas qu’une bombe, un outil spécifique dans la défense. C’est beaucoup plus que cela. C’est une cohérence d’ensemble. C’est une pensée stratégique. C’est un système d’armée avec une intégration opérationnelle, technologique et industrielle du conventionnel et du nucléaire. Ce sont effectivement des technologies « duales ». C’est un mode de gestion en soi de la recherche et de la maintenance, avec des investissements incontournables. C’est un budget adapté… Cette complexité fait douter de la possibilité même d’une maintenance à durée déterminée de la dissuasion nucléaire. Le nucléaire ne peut pas être éphémère. C’est bien pour cette raison que les partisans de la force de dissuasion prétendent aujourd’hui « qu’on ne peut pas désinventer » le nucléaire militaire face à ceux qui, à juste titre, mènent bataille pour son élimination complète, multilatérale et contrôlée (comme le demande le Traité de non-prolifération). En vérité, entre un maintien (sous quelque forme que ce soit) et l’élimination… il n’y a pas de troisième voie.
Ce que tous ces débats traduisent c’est donc aussi une vulnérabilité de la conscience politique sur le problème de l’existence des armes nucléaires et de leur rôle stratégique dans l’ordre international. On voit comment, du point de vue du PCF, le Rapport Kanapa, les confrontations politiques de l’époque avec le PS mais aussi avec le PCUS ([6])…. comment tout ceci conduit à traiter des armes nucléaires sur un plan strictement politique, sans que la question fondamentale de la légitimité de l’existence de ces armes ne soit au posée. Tout le débat s’ordonne autour de la doctrine de dissuasion comme réponse incontournable, sans égard pour la réalité d’une arme effectivement inutilisable, mais une arme politique qui exprime d’abord la puissance et la hiérarchie des puissances. Une arme politique qui, hier comme aujourd’hui, contribue à faire de « l’équilibre » des insécurités et des menaces la condition sine qua non de la sécurité internationale… On marche sur la tête. La course aux armements et les politiques de puissances, après la 2ème Guerre mondiale, ont conduit à une impasse historique : la guerre dans ses configurations classiques n’est plus possible. La centralité stratégique des armes nucléaires la rend suicidaire pour l’humanité. A l’évidence, dans une telle situation, hier comme aujourd’hui, c’est d’abord l’existence même des armes nucléaires qui doit être au centre des débats et des batailles.
La sécurité par l’élimination des armes nucléaires
L’enjeu de la sécurité internationale et de la sécurité de la France est donc indissociable d’une perspective d’élimination des armes nucléaires. Accepter une « maintenance » de la force de dissuasion c’est renoncer à cette exigence. Pour le PCF, même en 1977, cela signifie inévitablement contribuer à brouiller sa propre image, altérer ses valeurs et le sens même de son action.
Le Rapport Kanapa suscita d’ailleurs un trouble réel au sein du Mouvement de la Paix, et même chez les Communistes, dans un contexte où, il faut le mesurer, l’ensemble de la gauche, y compris le PCF avant le Rapport Kanapa, s’exprimait pour l’interdiction et l’élimination des armes nucléaires. Daniel Durand, ancien Secrétaire national du Mouvement de la Paix, souligne « qu’après deux mois de débats et une session animée de son Conseil national les 1er et 2 octobre 1977, Le Mouvement de la Paix réaffirme son opposition irréductible à toutes les armes nucléaires et sa volonté de tout mettre en œuvre pour leur interdiction dans tous les pays. Le débat n’est pas tranché entre ceux, dans le Mouvement, qui sont pour une renonciation française unilatérale (ce qui était la position dominante jusqu’à présent) et ceux qui, soutenant l’argumentation du Programme commun actualisé, estiment que la renonciation est impossible, tant qu’un accord de désarmement général n’interviendra pas » ([7]).
Ce que le Rapport Kanapa veut résoudre ainsi ce n’est pas le problème de la défense et du nucléaire. C’est bien la question de l’accession du PCF aux responsabilités gouvernementales pour la mise en œuvre de grandes réformes sociales et démocratiques. La méthode choisie est manifestement une erreur grave. Quant à François Mitterrand, il a su jouer sur l’espoir grandissant dans le pays d’un changement politique favorable à la gauche, en cherchant à en rassembler les conditions politiques et électorales, sans se lier les mains avec un Programme commun aux contenus avancés. Pour Mitterrand, il n’est pas question que la gauche au gouvernement revienne sur l’appartenance de la France à « sa famille atlantique »… comme dira Nicolas Sarkozy quelque 30 années plus tard ([8]).
En 1981, François Mitterrand se fera élire à la Présidence de la République sur la base de ses « 110 propositions pour la France » qui réduisent à peu de choses l’esprit et les contenus du Programme commun sur les enjeux touchant à la défense. Il ne subsiste guère qu’une politique de désarmement progressif visant à l’équilibre des forces, une action contre la dissémination (non-prolifération), l’ouverture d’une négociation sur la sécurité collective en Europe, une stratégie autonome de dissuasion… La perspective d’une dissolution des blocs est passée à la trappe. Ainsi, de Giscard à Hollande et Macron en passant par Mitterrand, on constate un processus d’intégration continu de la France dans l’organisation politico-militaire (et nucléaire) du monde capitaliste occidental : l’OTAN. Atlantisme et dissuasion nucléaire se sont étroitement liés dans la durée.
Le mythe du « gaullo-mitterrandisme »
On mesure ainsi à quel point François Mitterrand a pu, à sa façon, faire reculer cette conscience collective fondée sur l’attachement à l’indépendance nationale et à la paix. Il s’agissait de « normaliser » le rapport de la France à l’Alliance atlantique. Par choix idéologique et pour s’ouvrir les conditions d’une majorité, Mitterrand su, à la fois, habilement préserver suffisamment longtemps la fiction d’une attitude commune, d’un accord PC/PS minimum sur la défense, tout en légitimant et en poursuivant l’aggiornamento en cours sur le statut et le rôle stratégique de la France dans le monde.
Il est utile de noter au passage que ce constat est en soi une réfutation de la thèse justifiant l’existence, aujourd’hui, d’un « gaullo-mitterrandisme » de politique étrangère, une prétendue antithèse au néo-conservatisme atlantiste. On est, d’ailleurs, censés observer une soi-disant résurgence « gaullo-mitterrandienne » avec Emmanuel Macron. Pour les pouvoirs exécutifs d’hier et d’aujourd’hui, l’atlantisme constitue un choix stratégique identitaire sur lequel – au delà des contextes et des méthodes choisies – nul Président (post-gaullisme) n’est revenu. Certains se plaisent à considérer les initiatives internationales d’ E. Macron comme autant de signes d’une France capable d’être plus indépendante… Comme si le rôle français d’aujourd’hui, en matière de politique internationale et de défense, n’était pas sur le fond, dans la continuité de ce qui le définit depuis des lustres, avec les cadres totalement assumés de l’OTAN, de l’intégration libérale et capitaliste européenne, jusqu’à la Françafrique. Ce qui fait la différence c’est une certaine insuffisance des présidences ayant précédé celle d’Emmanuel Macron, en particulier celle de François Hollande. Une insuffisance qui apparaît avec tant d’évidence dans cet effarant livre-aveu « Un Président ne devrait pas dire ça… » ([9]).
La thèse « gaullo-mitterrandienne » est cependant problématique plus particulièrement quant au sujet nous intéressant ici. Elle tend, en effet, à légitimer l’idée de convergences essentielles entre l’homme du 18 juin 1940 et l’élu du 10 mai 1981. Il est vrai que François Mitterrand montra au cours de sa Présidence ce que certains aiment à lui reconnaître : une culture et une certaine vision du temps long. Dans une période qui imposa des bouleversements géopolitiques de grande portée, il fallait nécessairement faire preuve de maîtrise. Mais cela ne confirme en rien le bien-fondé d’un « gaullo-mitterrandisme ». De Gaulle fut un homme de l’histoire alors que celle-ci se décomposait/recomposait dans la guerre, dans la tragédie mondiale et dans une mutation de grande ampleur de l’ordre mondial. François Mitterrand fut un homme de la politique, qui contribua à dessiner/imposer le cadre durable d’un alignement atlantiste pour la France. Ni les circonstances, ni les choix ne permettent de justifier le mythe « gaullo-miterrandien » puisque, justement, c’est ce Président de la « force tranquille » qui, après le très libéral et atlantiste VGE, permit aux socialistes de poursuivre et développer le processus de codification et d’alignement atlantiste.
Le Rapport Kanapa a la vie dure dans un monde qui change
Il y a, dans les débats et les confrontations politiques de la décennie 70, tout ce qui va mûrir et éclater dans la décennie suivante : la crise décisive du modèle soviétique, la crise structurelle du modèle libéral capitaliste, la crise d’un ordre bipolaire antagoniste établi sur la centralité de l’arme nucléaire. Le bouleversement géopolitique qui va changer totalement la donne internationale et stratégique avec, en Europe, la chute du Mur de Berlin, l’écroulement des régimes de l’Est et du Pacte de Varsovie, va balayer les problématiques caractéristiques de la Guerre froide et de la 2ème partie du vingtième siècle. Mais des enjeux essentiels ne disparaissent pas. Ceux de la guerre, des logiques de puissance et de domination, de la sécurité et des armes nucléaires subsistent dans un contexte où les approches politiques doivent être nécessairement bousculées, transformées. Alors que s’ouvre une nouvelle phase historique dans laquelle montent les enjeux du social dans l’ordre mondial, et les impasses politiques et systémiques du capitalisme, tout doit être repensé, jusqu’à l’analyse des causes des insécurités, et jusqu’aux politiques nécessaires pour construire un nouvel ordre de paix et de sécurité humaine.
L’ordre mondial est bouleversé mais le Rapport Kanapa a pourtant la vie dure. Dans « L’espoir au présent » ([10]), écrit en 1980, Georges Marchais souligne « qu’une force de dissuasion nucléaire convenablement maintenue en état, est indispensable à la France ». Dans « Le 3ème Grand, une chance pour la paix », écrit en 1984, Maxime Gremetz ([11]) justifie longuement le Rapport Kanapa. Il écrit un autre ouvrage intitulé « Et pourtant elle tourne » en 1987. On sent alors un bougé du positionnement, 10 ans après le Rapport Kanapa, dans une phase, il est vrai, d’intense négociations internationales pour le désarmement nucléaire. En janvier 1986, Mikhaïl Gorbatchev propose l’élimination de l’ensemble des armes nucléaires à l’horizon de l’an 2000. Les pourparlers de Reykjavik en octobre 1986, entre Reagan et Gorbatchev, n’aboutissent pas à un accord, mais ils permettent le traité de grande importance qui va suivre (signé en décembre 1987), pour l’élimination des forces nucléaires à portée intermédiaire (entre 500 et 5500 km de portée). Le PCF fait alors le choix de soutenir la proposition Gorbatchev et les avancées possibles en faveur du désarmement. Ce deuxième livre de M. Gremetz témoigne de ce changement. Le contexte permet de fermer la parenthèse du Rapport Kanapa… sans le dire explicitement. Sans affirmer nettement et définitivement une position du PCF fondée sur l’interdiction et l’élimination des armes nucléaires. Tout devrait y conduire, pourtant…
Maxime Gremetz écrit : « alors que l’enjeu est de faire disparaître toutes les armes nucléaires, on nous dit : il faut garder la bombe française, pour toujours ! Eh bien non, nous voulons, nous les Communistes, la voir disparaître le plus vite possible avec toutes les autres ». Des esprits chagrins souligneront peut-être que la formule « pour toujours » n’est pas innocente. Elle pourrait signifier, pour le PCF, que la France pourrait conserver sa force de frappe… pas pour toujours mais pour un temps… Chacun sait qu’évidemment une élimination multilatérale des armes nucléaires ne peut être qu’un processus complexe, non défini dans la durée. Le « pour toujours » – les mots sont décidément importants – laisse donc une sorte d’ultime ambiguïté : le PCF constate-t-il simplement et logiquement que l’élimination des armes nucléaires est une bataille dans le temps et dans les rapports de forces existants ? Ou bien cherche-t-il, 10 ans après le Rapport Kanapa, à ne pas se déjuger totalement en utilisant une formule subtilement difficile à décrypter ?
Comment on ferme une parenthèse… sans le dire, tout en voulant le montrer
De la même manière que les décisions prises à l’époque, par le PCF, sur la défense comme sur d’autres sujets sensibles, n’ont, bien souvent, guère fait l’objet de débats internes impliquant l’ensemble des adhérents du parti… cet art consommé de fermer une parenthèse politique sans le dire, tout en voulant le montrer, ressort d’une méthode semblable, malgré un appel permanent au débat.
En réalité, la page du Rapport Kanapa n’a jamais été clairement et explicitement tournée. Le discours et les initiatives du PCF pour la paix et le désarmement ne masquent pas cette persistance de longue durée dans une ambiguïté qui nuit aux nécessités de la cohérence et à la crédibilité de l’expression. Et cette ambiguïté perdure aujourd’hui. Sur le site du PCF ([12]) figure un long document intitulé « Pour une politique de défense nationale garantissant l’indépendance du peuple français ». Ce document est présenté comme une « contribution des camarades de la Commission défense nationale et paix du PCF » pour le congrès du parti tenu en juin 2016 à Aubervilliers.
Le document réaffirme l’objectif « d’un désarmement nucléaire multilatéral et général ». Il souligne cependant qu’il est nécessaire de « s’interroger sur la pertinence de garder l’arme nucléaire, mais aussi à se demander si l’existence d’une force nucléaire stratégique ne participe pas à l’absence actuelle d’une telle menace ». Une telle formulation se situe complètement dans la logique classique de la dissuasion. Elle suggère que, pour le PCF (ou au moins pour une partie de sa direction), subsiste encore un doute. Comme si le PCF, près de 40 années après, n’était pas encore sorti du Rapport Kanapa… Ce document le laisse croire, qui pose notamment trois questions très datées, peu ou mal inscrites dans les enjeux stratégiques actuels relatifs aux nouvelles réalités des conflits et de l’ordre international :
« – En l’état actuel du monde, l’existence d’une force nucléaire française sous la seule responsabilité de notre pays est-elle une garantie de l’indépendance de la défense française ?
- la force nucléaire française constitue-t-elle par son existence une protection efficace face à des menaces actuelles, potentielles et à venir qui pèsent ou pèseront sur notre pays ?
- le démantèlement unilatéral de tout ou partie de l’arsenal nucléaire français aurait-il un impact positif sur la prolifération, le désarmement nucléaire et la sécurité du monde ? ». On observe que ces trois questions, sur le fond et dans l’ordre de présentation, reprennent les mêmes thématiques que les trois questions extraites des archives de Jean Kanapa et reproduites par Gérard Streiff dans « Jean Kanapa 1921-1978 » (tome 2, page 109 et 110) ([13]). Il est difficile de ne pas faire le rapprochement.
Cette situation d’ambiguïté ou d’un manque de clarification pèse sur les options nécessaires à la bataille pour le désarmement nucléaire. Cela conforte, dans le débat public, ceux pour qui existerait en France « un consensus national » sur la dissuasion nucléaire. Ce consensus national, en vérité, n’a jamais existé, même si le mouvement pacifiste français, dans sa diversité, n’eut pas toujours l’ampleur de ce qu’il fut ailleurs, en Allemagne ou en Grande-Bretagne par exemple. Mais l’existence et l’influence de ce mouvement aux multiples dimensions associatives et politiques interdit de parler de consensus. Les sondages actuels sur une opinion publique très favorable à une signature française du Traité d’interdiction des armes nucléaires adopté à l’ONU en 2017 révèle une préoccupation citoyenne plus forte qu’on ne le dit. Le contexte actuel, malgré un climat de tensions, est, de fait, singulièrement marqué depuis le début des années 2000 par des faits majeurs : grandes conférences et appels de haut niveau, discours d’Obama à Prague et visite à Hiroshima, création du Mouvement ICAN (Prix Nobel de la Paix 2017), adoption du Traité d’interdiction des armes nucléaires, Traité « New-Start » de réduction des armes stratégiques (2010), accord sur le nucléaire iranien (2015)… Ce contexte est des plus opportuns pour une bataille déterminée sur les enjeux liés aux armes nucléaires.
Il faut donc répondre à la question cruciale : comment construit-on de la sécurité dans le monde d’aujourd’hui ? Ce qui est nécessaire c’est l’engagement sans équivoque pour l’interdiction et l’élimination des armes nucléaires…C’est l’action pour la baisse des tensions, la résolution des conflits, la création de la confiance, la contribution à des avancées de sécurité collective. La sécurité est d’abord un fait politique, une construction collective et multilatérale, d’où l’importance cruciale du cadre des Nations-Unies… donc de la valorisation de tous les actes, de l’ensemble des traités (y compris les plus récents) ayant contribué, depuis la fin de la 2ème Guerre mondiale, à mettre en place un corpus juridique et politique donnant un cadre légitime à la sécurité collective. Il ne faut pas laisser Donald Trump saper les bases de ce précieux cadre comme il tente de le faire en exacerbant les rivalités de puissances et les conflits. La maîtrise des enjeux du temps présent se fait pressante et plus exigeante que jamais.
[1] C’est la mise en place des réunions au Sommet dites G5 (1974), G6 (1975), G7….
[2] Ce rapport n’est pas diffusé intégralement. L’Humanité en publie l’essentiel le 12 mai 1977. Dans cette version plus courte le sens du Rapport n’est pas modifié.
[3] C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui encore avec les armes nucléaires aéroportées désignées pour une fonction « d’ultime avertissement », c’est à dire une fonction offensive de frappe en premier.
[4] Voir « Jean Kanapa, 1921-1978. « Une singulière histoire du PCF », Gérard Streiff, l’Harmattan, 2001, tome 2, page 113.
[5] « Les mondes de François Mitterrand. A l’Élysée 1981-1995 », Hubert Védrine, Fayard, page 49.
[6] D’une part, le PCUS se fait critique sur la prise de distance du PCF vis à vis du modèle soviétique. D’autre part, l’URSS tend à vouloir intégrer l’arsenal français dans les évaluations sur l’équilibre des forces Est/Ouest, ce qui est en soi contradictoire avec la volonté du PCF de donner à la force de dissuasion française une posture totalement indépendante des blocs.
[7] Conversation, le 22 août 2018, avec Daniel Durand, ancien Secrétaire national du Mouvement de la Paix, qui travaille actuellement sur une histoire du Mouvement de la Paix français.
[8] Avec notamment la réintégration quasi-complète de la France au sein du Commandement militaire intégré, sur décision de N. Sarkozy, en 2007.
[9] Voir « Un Président ne devrait pas faire ça…Inventaire d’un quinquennat de droite », Éditions Syllepse, J. Fath, page 107.
[10] « L’espoir au présent », Georges marchais, Éditions sociales, Notre temps/tribune, 1980, page 164.
[11] Maxime Gremetz prend la suite de Jean Kanapa en 1978. Il sera le responsable de la politique extérieure du PCF jusqu’en 1992.
[12] http://congres.pcf.fr/85483
[13] Voici le texte de Jean Kanapa : « Nous posons trois questions : 1) à quelles conditions la bombe peut être UN des instruments véritablement indépendant de notre défense nationale ? Et non plus dans la dépendance de l’Alliance atlantique ? 2) Est-on d’accord pour que la sécurité française repose sur une stratégie fondée sur la seule défense du territoire national tous azimuts ? 3) Soutenir et proposer toutes initiatives en vue d’un processus de désarmement reposant sur la sécurité égale ».
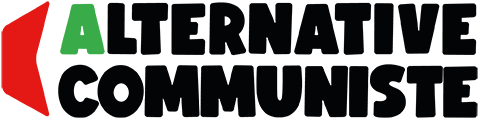
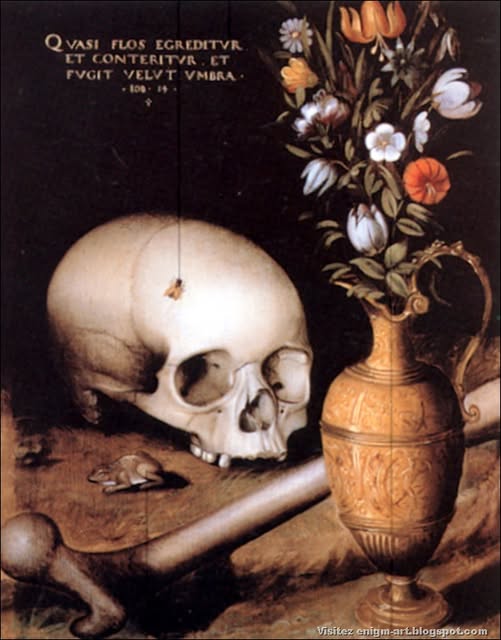


Laisser un commentaire