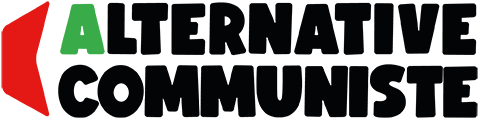Face à la guerre et au chaos écologique, renouer avec l’internationalisme
Le monde bascule dans une spirale de guerres et de militarisation croissante, alors même que la crise écologique atteint un point de rupture. Les réponses politiques dominantes oscillent entre un alignement sur les stratégies atlantistes et un repli souverainiste, incapable de répondre aux défis globaux. Pourtant, il est urgent de refuser cette impasse et de reconstruire un internationalisme populaire, seul horizon capable d’articuler justice sociale, écologique et paix durable.
La menace majeure qui pèse aujourd’hui sur l’humanité n’est pas uniquement militaire : elle est écologique et systémique. L’effondrement climatique, la raréfaction des ressources, la destruction des écosystèmes, l’insécurité alimentaire et les crises de l’eau ne sont pas des menaces lointaines, mais des réalités immédiates qui déstabilisent nos sociétés. Or, loin de chercher à y répondre, les grandes puissances s’enferment dans une fuite en avant guerrière et productiviste, où l’accaparement des ressources et la concurrence mondiale accélèrent à la fois la catastrophe environnementale et les conflits armés.
Cette logique destructrice s’incarne tragiquement dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. L’invasion impérialiste du territoire ukrainien, l’annexion illégale de territoires, les crimes de guerre commis contre les populations civiles et la tentative d’asservissement d’un peuple tout entier ne peuvent être relativisés. La solidarité avec le peuple ukrainien doit être totale, tout comme le refus d’une lecture géopolitique simpliste qui réduirait ce conflit à un affrontement de blocs. L’Ukraine a droit à son autodétermination, et la seule issue viable passe par une paix négociée garantissant sa souveraineté, tout en construisant une sécurité collective qui empêche toute nouvelle agression.
Dans ce cadre, il est essentiel de rappeler les accords de Minsk, qui prévoyaient une solution politique au conflit en Ukraine dès 2015, avec une autonomie pour le Donbass et un engagement de neutralité militaire. Leur sabotage par les acteurs occidentaux et leur rejet par la Russie ont conduit à l’impasse actuelle. Toute perspective de paix doit réintégrer ces éléments fondamentaux pour éviter une reprise infinie du cycle de la guerre. Le droit international ne peut souffrir d’une lecture à géométrie variable : nous sommes tout aussi solidaires du peuple ukrainien que du peuple palestinien, tous deux victimes de logiques de domination et d’occupation qui bafouent leurs droits fondamentaux. Refuser ces contradictions, c’est affaiblir toute possibilité de construire un cadre international fondé sur la justice et la souveraineté des peuples.
Dans ce contexte de crises multiples, l’arrivée au pouvoir par les urnes de régimes autoritaires d’inspiration fasciste, comme ceux de Trump aux États-Unis, Orban en Hongrie ou Meloni en Italie, aggrave encore la situation. Ces gouvernements exploitent la peur et la colère des peuples pour imposer des politiques régressives, exacerber les tensions internationales et renforcer une lecture nationaliste et xénophobe des enjeux mondiaux. Ils contribuent activement à l’affaiblissement du multilatéralisme et du droit international, légitimant les logiques de guerre et de confrontation au détriment des peuples. Leur montée en puissance, loin d’être un phénomène isolé, est le produit d’un capitalisme en crise qui ne trouve d’autre issue que l’autoritarisme et la répression pour maintenir l’ordre établi.
L’analyse de ces conflits ne peut se limiter à une opposition binaire entre un impérialisme russe et un bloc occidental. Il s’agit de comprendre les dynamiques structurelles à l’œuvre : la recomposition des alliances internationales, la montée en puissance de nouveaux pôles de domination et l’érosion du multilatéralisme. Le capitalisme mondialisé en crise alimente les tensions géopolitiques, et c’est en refusant la fatalité de ces affrontements que l’on peut proposer une alternative politique viable.
Le risque aujourd’hui est de voir l’Europe s’aligner sur une logique atlantiste qui ne laisse aucune place à l’émergence d’une diplomatie propre et indépendante. Le réarmement généralisé, présenté comme une nécessité stratégique, ne fait qu’aggraver les tensions et repousser toute perspective de négociation. Cette politique, couplée à une austérité renforcée et à une réallocation des budgets publics vers l’effort de guerre, plonge l’ensemble du continent dans une spirale destructrice. La guerre devient le prétexte à toutes les régressions sociales, et l’urgence écologique est sacrifiée sur l’autel de la militarisation.
L’histoire offre des enseignements précieux. Des tentatives passées, comme l’eurocommunisme, avaient cherché à articuler démocratie radicale, transformation sociale et coopérations transnationales. Il ne s’agit pas d’idéaliser ces expériences, mais d’en retenir une intuition centrale : sortir des logiques de blocs, refuser à la fois l’alignement impérialiste et le repli national, et construire un projet politique partagé entre les peuples.
Cela implique aujourd’hui une rupture nette avec l’Union européenne telle qu’elle fonctionne, qui protège avant tout les marchés et organise la mise en concurrence des travailleurs. Plutôt que d’accepter cet état de fait, il est nécessaire de refonder un espace commun en Europe et en Méditerranée, fondé sur la justice écologique, sociale et démocratique. Cette alternative est d’autant plus urgente que les nationalismes autoritaires prospèrent sur l’impuissance politique et la colère des peuples. Des figures comme Trump, Meloni ou Le Pen instrumentalisent ces crises pour opposer les travailleurs entre eux et légitimer de nouvelles aventures guerrières et sécuritaires.
Face à eux, l’internationalisme populaire n’est pas une utopie dépassée : il est la condition de notre survie collective. C’est lui qui permettra de désarmer les puissances, de mutualiser les ressources, d’accueillir dignement celles et ceux que les crises déplacent, et de bâtir des sociétés résilientes et justes.
Oui, sortons de l’OTAN. Oui, rompons avec les logiques de guerre, de pillage et de concurrence. Oui, construisons ensemble, une diplomatie du non-alignement, un horizon commun de paix, de justice sociale et de transition écologique.
Car la paix ne se résume pas à l’absence de guerre : elle est l’organisation collective et solidaire d’un monde où les peuples reprennent en main leur avenir, loin des logiques de domination et de destruction. C’est cela, aujourd’hui, le véritable projet révolutionnaire.