Séquence 1
C’est en lisant l’interview de Léon Deffontaines paru dans l’édition du 30 août du Travailleur catalan, l’hebdomadaire communiste des Pyrénées-orientales, que j’ai compris pourquoi j’avais été chiffonné à la lecture des reportages sur l’université d’été du PCF parus les 24 et 25 août sur le site de L’Humanité. Il y était question, entre autres, de l’analyse de la séquence électorale des européennes et des législatives anticipées. Léon Deffontaines, chargé de l’exposer à l’auditoire, aurait déclaré que : « nous (les communistes. NDLR)) ne sommes pas parvenus à aller chercher de nouveaux électeurs dans les classes populaires ». Il aurait alors appelé à un « grand débat » pour « réorganiser notre parti afin que de tels échecs ne se reproduisent plus ». Le journaliste, dubitatif, avait fait ce commentaire : « S’il n’évacue pas la question de la « ligne politique », il met surtout l’accent sur l’organisation du PCF lui-même, des liens entre ses instances nationales et ses fédérations ».
Le dirigeant communiste avait-il suggéré que si Fabien Roussel, aux présidentielles, et lui même, aux européennes, n’avaient pas obtenu les résultats attendus, c’était en raison des défaillances de l’organisation de leur parti ?
L’explication était à ce point piteuse que j’avais mis cela au compte de l’incompréhension du journaliste de L’Humanité. Mais après la lecture de l’interview de Deffontaines paru dans le TC, j’ai du me rendre à l’évidence, il n’y avait pas d’équivoque. Je cite ses propos : « Je sors justement d’un atelier sur les bilans des élections du Parti. Et là où tout le monde s’attendait à ce qu’on fasse un bilan sur tel discours qui n’a pas été, le bilan a en grande partie porté sur les défaillances en termes d’organisation. Comment on permet d’avoir une organisation structurée sur tout le territoire, une forme d’homogénéité, en tout cas sur les gestes d’organisation. Comment on permet justement d’avoir un parti qui est capable d’avoir le meilleur discours, d’avoir le même tract et les mêmes discours auprès de toute la population ! C’est ce débat qu’on a eu lors de cet atelier. C’est le débat qu’on a depuis le début de cette université d’été, et je dirais qu’en fait on a des universités assez inédites cette année. Je pense que c’est un bon levier pour déjà réfléchir à la manière dont on doit s’organiser pour aller chercher les classes populaires, tous les travailleurs, tous les ouvriers et les faire adhérer au parti. »
Séquence 2
Mon post précédent publié sur ma page Facebook, a suscité de nombreuses réactions, le plus souvent épidermiques, qui montrent, une nouvelle fois, combien le débat est difficile.
Il est vrai que j’avais écrit un texte court qui n’explicite pas les tenants et aboutissants, de ce qu’il faut penser du point de vue de Léon Deffontaines, vraisemblablement représentatif de celui de l’exécutif du PCF, selon lequel, il faudrait, suite aux échecs des deux dernières élections, « réorganiser notre parti afin que de tels échecs ne se reproduisent plus ». En d’autres termes, ces échecs s’expliqueraient par les défaillances de l’organisation du PCF.
La question, qu’en quelque sorte je posais abruptement était : l’analyse de l’exécutif du PCF, est-elle pertinente ? J’ai répondu par la négative. Et, effectivement, elle me paraît si aberrante, en tant qu’elle est émise par les plus hauts responsables du PCF, que je l’ai taxée de « piètre » et de piteuse ».
Selon moi, pour fonder une explication qui peu susciter un débat utile, il faut, au préalable, examiner l’évolution de l’influence électorale du PCF sur le temps long. Jusqu’en 1960, son score électoral se situe autour de 25%. Les premiers indices de son recul remontent à 1965 et se précisent avec Mai 68. Dans la période qui suit, son score reste toutefois au dessus de la barre des 20%. De sorte que le courant révolutionnaire qu’il incarne prévaut toujours sur le courant réformiste représenté par le PS, sans pour autant le dominer comme dans la période antérieure. . Aux élections législatives de mars 73, soit après la signature du Programme commun, il fait plus de 21% contre 19% pour le PS. A partir de 74, le recul s’amorce. L’influence électorale des deux courants s’inverse, et va aller se renforçant. L’explication qu’en ont donné les directions successives du PCF, singulièrement pendant la période Marchais (72-94), portait, d’abord sur les défaillances de l’organisation, et aussi sur l’incidence des contestations internes.
A partir de 80, ce n’est plus de recul dont il s’agit, mais de l’amorce du déclin (aux élections présidentielles de mai 81, G. Marchais ne recueille que 15,4% contre 25,9% pour F. Mitterrand). A partir de ce moment, la régression se poursuit et la barre des 10% est de plus en plus difficilement franchie. Puis très vite elle chute pour s’approcher des 2%.
Sous les directions de Robert Hue, puis Marie-George Buffet en ensuite Pierre Laurent, l’analyse de ce recul suivi du déclin ont été tentées mis ont lamentablement échoué. Et, ce n’est pas sous la direction de Fabien Roussel, qu’il faut espérer que s’engage une réflexion approfondie. Au contraire, le déni, l’occultation et la diversion l’ont emporté. Tout indique que le déclin va empirer et conduire au dépérissement du PCF.
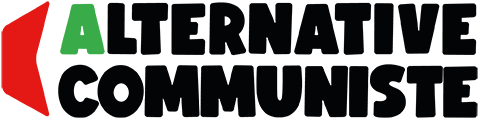



Laisser un commentaire