LFI est un mouvement qui m’intrigue. Une des raisons tient au fait que je n’ai pas de culture mouvementiste, particulièrement s’agissant d’un mouvement politique dont le fonctionnement m’échappe. Une autre raison tient au fait que ce mouvement reste dominé par la personnalité de Jean Luc Mélenchon à l’égard duquel je suis tiraillé entre la suspicion que j’ai toujours éprouvé pour celui qui fut un très proche de François Mitterrand, l’admiration pour sa campagne de la Présidentielle de 2012 (rien de comparable en 2017 et encor moins 2022) et l’agacement pour ses sorties intempestives et dominatrices.
Mais, il se trouve que LFI est devenue la plus importante composante de la gauche de rupture, et, pour qui aspire à ce que l’on se débarrasse du capitalisme, le devenir de la gauche de rupture est crucial.
Or il se trouve que je viens d’achever la lecture « Nouveau peuple, nouvelle gauche » ouvrage qui m’a beaucoup appris sur les attendus de la « nouvelle stratégie » de LFI. Je me propose d’en rendre compte avant de formuler quelques hypothèses personnelles.
L’institut de la Boétie, Fondation insoumise
« Nouveau peuple, nouvelle gauche » a été publié sous l’égide de l’Institut de la Boétie, la Fondation créée par LFI en octobre 2019. Cet institut se présente comme étant à la fois « un lieu d’élaboration intellectuelle de haut niveau et un outil d’éducation populaire. » De « haut niveau », je ne saurais dire, mais ce qui est sûr c’est qu’y sont organisées des séances de travail auxquelles participent des chercheurs en sciences sociales et politiques. Leurs contributions sont réunies dans des ouvrages collectifs dont le premier a été publié en 2024 sous le titre : « Extrême droite : la résistible ascension » (l’ouvrage est coordonné par Ugo Palheta, auteur d’un travail de recherche publié sous le titre : « Comment le fascisme gagne la France, de Macron à Le Pen », dont j’ai rendu compte dans un post daté du 1er septembre)
« Nouveau peuple, nouvelle gauche »
L’ ouvrage s’ouvre par un dialogue entre Nancy- Fraser, philosophe et pionnière du féminisme et J-L Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie. Je ne commente pas cet échange car j’ai l’intention de revenir sur le travail de recherche de Nancy Fraser qui a fait l’objet d’un ouvrage : « Le capitalisme est un cannibalisme ». Quant à JLM, il développe des théorisations hasardeuses reprises de son livre de 2024 : « Faites mieux. Vers la révolution citoyenne ». Frédéric Lordon en a fait une critique savante et sévère dans son blog du Monde diplomatique, ( « La France insoumise est-elle anticapitaliste ? » 3 octobre) qui, pour l’heure, n’a pas sa place ici.
Un mouvement « gazeux »
Comme dans le précédent livre de l’Institut de la Boétie, c’est Clémence Guetté, co-présidente de cet organisme , députée insoumise, qui dans une postface tire les principaux enseignements des 17 contributions rassemblées dans le livre. Ces enseignement dont il va être question justifient ce qu’elle nomme « la forme gazeuse de son mouvement ». Cette forme, dit-elle, « permet de faire cause commune avec des mouvements populaires extrêmement variés et de faire front avec des militants de tous horizons » et, ajoute-elle, cette forme a « pour objectif de pouvoir être très facilement investie par des personnes de milieux populaires qui ne se sentent parfois pas légitimes pour participer aux activités des organisations politiques traditionnelles » Il n’est pas surprenant qu’elle tienne des propos assez durs à l’encontre des partis politiques. Cette opinion est discutable. C’est d’ailleurs ce que fait Julian Mischi dont la contribution est la seul à aborder la question du « modèle militant », contribution à laquelle Clémence Guetté ne fait pas référence.
Une approche intersectionnelle
Autant dire que je n’ai pas été convaincu par « la forme gazeuse », par contre, c’est d’une tout autre façon que je considère le cœur de l’argumentation de ce livre. L’argumentation est fondée sur l’analyse des classes populaires. Elle reste encore incertaine ne serait-ce qu’au niveau de la terminologie. Elles peuvent être indifféremment : « une catégorie sociale »», des « milieux populaires », des « mondes populaires ». Mais, en tout état de cause, ces couches populaires « sont les premières victimes du capitalisme » et leur « destin n’est pas automatiquement lié à celui de la gauche ». De sort que l’objectif de la gauche de rupture est « de construire un bloc populaire, un peuple révolutionnaire ». Ce mot peuple est polysémique, mais ici il est utilisé dans le sens de « faire peuple », en d’autres termes, construire par l’action politique l’unité des classes populaires « structurellement hétérogènes et fragmentées ». Ce qui implique que pour appréhender cette hétérogénéité il faut « adopter une approche intersectionnelle qui mêle propriétés sociales, raciales, territoriales, générationnelles et genrées ( Julien Talpin). Ce que Clémence Guetté traduit par : « les rapports de domination racistes et genrés s’ajoutent à l’exploitation capitaliste »
Rapports entre classes populaires et gauche
Des contributions de ce livre il ressort deux constats qui vont à l’encontre d’idées reçues : d’une part, il n’y a pas divorce entre la gauche et les classes populaires et d’autre part, elles n’ont pas été conquises par les idées de l’extrême droite. Par contre, si divorce il y a eu, c’est entre les couches populaires et la social-démocratie. Le jugement de Clémence Guetté est sans appel : « la social démocratie est capitularde, capable de toutes les compromissions.. » Quant au comportement électoral des couches populaires, Clémence Guetté prend appui sur l’étude sociologique de Vincent Tiberj : « Les classes populaires : droitisation ou grande démission ? » pour conclure que « le comportement électoral majoritaire des classes populaires est l’abstention et les personnes les plus précaires votent majoritairement pour notre famille politique » (Vincent Tiberj est l’auteur d’un travail de recherche paru sous le titre : « La droitisation française mythe et réalités »).
Une gauche de rupture
Clémence Guetté et sans nul doute avec elle la direction de LFI affirme vouloir s’appuyer sur ces analyses pour fonder une stratégie nouvelle dans le but que les classes populaires « atomisées, fragmentées et et plurielles » fassent peuple et que ce « peuple nouveau » constitué de toutes les catégories sociales « qui sont aujourd’hui au cœur des processus d’accumulation, de domination, d’exploitation et d’appropriation » Elle précise que « les rapports de domination racistes et genrés s’ajoutent à l’exploitation capitaliste » Il faut donc, selon elle, créer une « gauche de rupture » dans laquelle « différents mondes populaires se reconnaissent et s’unissent » Sur le plan électoral, il s’agit de faire reculer le phénomène abstentionniste massif qui affecte les couches populaires. Et pour construire « ce bloc de rupture » il faut « ne pas hiérarchiser telles ou telles lutes ou dominations mais de proposer un projet d’ensemble qui les prend toutes à bras le corps ». Ce bloc de rupture pour gagner les élections n’est qu’une « étape stratégique de la révolution citoyenne »car les objectifs de LFI ne se limitent pas aux victoires électorales, ils sont « de placer la société sur le chemin d’un dépassement du capitalisme » Pour l’heure on en saura pas plus.
QUELQUES HYPOTHÈSES PERSONNELLES
C’est à partir de la lecture de cet ouvrage que je me risque à quelques hypothèses hautement contestables :
1- Vouloir se présenter comme la gauche de rupture a pour corollaire de n’accepter aucun compromis avec la droite au pouvoir, compromis dont cette dernière prétexte pour éviter le chaos institutionnel alors qu’elle en porte l’entière responsabilité. D’où les refus successifs de LFI de répondre aux invitations de Macron et des premiers ministres.
2- Tout indique que LFI considère que la social-démocratie n’est plus (définitivement?) à gauche. En quelque sorte elle en aurait fini avec sa fonction historique d’être la branche réformiste du mouvement ouvrier, celle révolutionnaire étant à l’origine incarnée par le PCF. Du coup, si le PS n’est plus à gauche et puisque le PCF est en voie d’extinction, c’est LFI qui prétend reprendre le relais de la révolution sociale. On peut penser que pour LFI c’est les écologistes partidaires qui assurent désormais la fonction réformiste. Dans ces conditions la thèse des « « deux gauches irréconciliables » puisque on se retrouve dans le schéma classique d’une gauche radicale et d’une gauche réformiste, lesquelles peuvent s’unir, ainsi qu’elle l’ont fait au moment du Front populaire face à la menace fasciste, menace qui ressurgit aujourd’hui.
2- A sa création LFI était une machine électorale au service des intentions présidentielles de J-L Mélenchon, ce dernier étant persuadé que la dynamique créée par une victoire présidentielle entraînerait celle aux législatives. C’était la conquête du pouvoir exclusivement par le haut. Or, cette stratégie a considérablement évoluée. LFI a décidé d’accéder à des pouvoirs locaux à l’occasion des élections municipales et départementales. Alors qu’hier les insoumis n’étaient pas des concurrents actifs des élu.es en place et des candidat.es socialistes communistes et écologistes, la donne vient de changer. D’une part LFI refuse de participer à des listes dans lesquelles le PS figure explicitement, et d’autre part, il revendique une place plus conforme à son influence électorale.
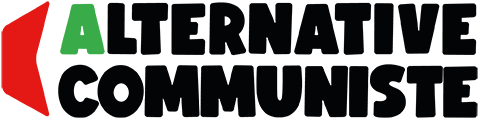
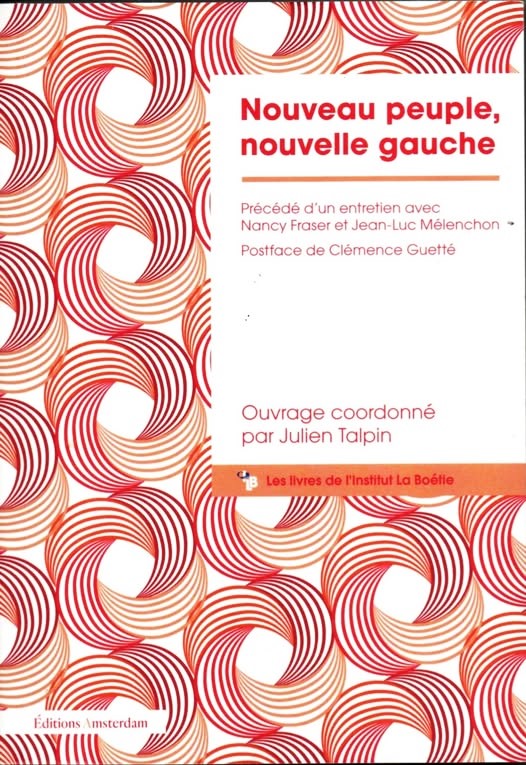


Laisser un commentaire