La bataille des idées et des imaginaires
Entretien avec Edwy Plenel, militant, journaliste, fondateur de Médiapart, auteur de plusieurs ouvrages dont « Pour Les Musulmans », il est un pourfendeur du colonialisme et du racisme structurel qui en découle.
L’entretien
Leïla Cukierman : Ce soir, nous voulons aborder la lutte contre l’extrême droite. Je vous propose que nous ayons, Edwy et moi, quarante-cinq minutes d’échange, puis que nous ouvrions ensuite la discussion à l’ensemble de l’assemblée. L’idée est de lancer quelques pistes de réflexion.
Au départ, avec Fabien, nous avions pensé travailler avec vous sur l’œuvre d’Édouard Glissant, que vous connaissez particulièrement bien, et sur ce qu’elle peut nous apporter : ce qu’elle peut nous suggérer, et les outils qu’elle peut nous donner pour penser et mener ce combat contre l’extrême droite.
Mais nous ne pouvons pas commencer ce soir sans évoquer le coup d’État au Venezuela. Je fais le lien entre votre présence parmi nous et votre engagement anticolonialiste — très tôt affirmé — ainsi que votre combat antiraciste. Or ce coup d’État, perpétré par la puissance impériale américaine et, fait rare, ouvertement revendiqué (contrairement à d’autres événements, comme le Chili, qui m’avait énormément touché en son temps), renvoie directement aux questions coloniales. Et, bien sûr, ces questions se croisent aussi avec celles de l’extrême droite : on le sait.
Je ne vais donc pas vous présenter : journaliste, essayiste, auteur notamment de Pour les musulmans — un livre qui m’avait beaucoup marqué — et cofondateur de Mediapart. Je voudrais plutôt partir de votre anticolonialisme et de votre antiracisme. Compte tenu des sujets que nous voulons aborder, j’aimerais aussi rappeler vos liens très singuliers avec la Martinique, et plus largement avec l’ensemble de l’arc antillais, si proche du Venezuela. On sait que Cuba est visée. On sait aussi ce que la colonisation a fait à Haïti.
Votre lien à la Martinique, c’est aussi celui de votre père, aux côtés d’Aimé Césaire, au moment de l’affaire Marajo en 59 — vous pouvez en dire quelques mots, si vous le souhaitez.
Et je voulais vous demander ceci : pensez-vous que votre anticolonialisme et votre proximité avec l’œuvre de Glissant viennent, en partie, de là ?
Edwy Plénel : Oui, bonsoir à toutes et tous, et merci pour l’invitation.
En fait, nous nous retrouvons à quelques semaines de l’anniversaire de la mort de Frantz Fanon, et l’an dernier était l’année de son centenaire. Dans mon itinéraire personnel, au fond, dans les constantes de mon engagement — qui a fini par se traduire en métier, par un journalisme radicalement démocratique — je suis un enfant de la question coloniale.
Je suis issu de cette histoire, d’abord parce que mon pays d’enfance a été la Martinique : le pays à la fois de Césaire, de Glissant et de Fanon. Un tout petit bout de territoire qui a produit — et ce ne sont pas les seules — trois œuvres qui continuent de parler au monde. Cette histoire, liée comme vous l’avez rappelé à des engagements familiaux, s’est poursuivie par un itinéraire qui m’a conduit, après mon enfance martiniquaise, à passer ma jeunesse en Algérie, après l’indépendance.
Cela peut vous paraître étrange, mais, dans ma tête, je suis en exil ici : je suis arrivé en France, à Paris, à l’âge de dix-huit ans, dans le climat et le contexte des années 1970. Et, pour ce qui est de ma période d’engagement militant, je n’ai d’ailleurs pas adhéré à une organisation française. Mes engagements militants ont commencé en Algérie, dans le cadre d’une Internationale — qui se voulait la Quatrième — sous la dictature de Boumédiène. Je voulais simplement rappeler cela, ainsi que le contexte : déjà, la question palestinienne était au cœur des espérances de révolution démocratique dans le monde arabe.
Pour répondre sur ce premier point — la question coloniale — et avec ce préambule, je précise que je ne suis spécialiste de rien. Je suis, comme vous toutes et vous tous, quelqu’un qui essaie d’y voir clair. Je pense qu’il faut d’abord comprendre ce qui nous arrive. J’essaie de le faire avec une forme de « foi du charbonnier », d’autant que j’ai sonné l’alarme depuis longtemps.
Vous avez évoqué Pour les musulmans, qui portait sur la fabrication de nouveaux boucs émissaires. Mais, avant la dernière présidentielle, j’avais réédité Le président de trop et publié À gauche de l’impossible, dont l’introduction s’intitule « Face à la catastrophe » et dont la première phrase dit en substance : « la catastrophe n’est pas à venir, elle est déjà là ». Je rappelle qu’il y a eu un premier mandat de Trump. Et, depuis, j’ai publié L’Appel à la vigilance, qui revient précisément sur la manière dont nous avons cédé — sur le terrain du langage, sur le terrain des mots — à l’extrême droite.
Pour moi, il faut d’abord comprendre ce qui nous arrive, parce que nous ne vivons pas simplement une répétition du même. Bien sûr, tout cela vient de l’impérialisme — notamment de l’impérialisme états-unien — et des logiques de puissance. Mais cela revient avec d’autres visages, sous d’autres apparences.
Nous vivons le retour en force de notre ennemi de toujours, qui prend différentes variantes mais reste unifié : l’adversaire du principe d’égalité, de l’égalité naturelle. Il est là, il est de retour. Il a le visage de Poutine, de Netanyahou, de Trump, de Milei, et de bien d’autres. Il faut donc comprendre comment cet ennemi de toujours — celui qui avait gagné à l’échelle du monde en 1940 — revient.
Quand on voit l’itinéraire de Retailleau et l’évolution de cette fusion des droites et de l’extrême droite, on retrouve le pétainisme. Les pétainistes n’étaient pas nécessairement « fascistes », mais ils étaient du côté de l’inégalité, de l’antisémitisme, de l’autoritarisme, de l’anti-démocratie, et ils ont entraîné derrière eux tout un appareil d’État qui a basculé du côté obscur.
Nous — ou plutôt les générations précédentes — avons vaincu cet ennemi en 1945. Mais il était resté en réserve. Il s’était retiré, il s’était abrité dans des refuges intellectuels que nous n’avons pas assez regardés : là, il a travaillé, il a réfléchi. Il attendait son heure, pour ce que j’appelle un capitalisme du désastre.
Et dans ce moment de crise, nous voyons bien que c’est un monde intenable : intenable du point de vue des inégalités ; intenable du point de vue des risques pour le vivant ; intenable, y compris pour notre espèce, dans cette course à l’avidité prédatrice.
Ce que nous avons sous les yeux ne nous est pas plus étranger qu’Hitler ne nous est étranger. Et, puisque vous l’avez rappelé, je veux insister sur un point : le message d’Aimé Césaire, dans le Discours sur le colonialisme, n’a pas été assez entendu. Ce texte — qui conduira ensuite à la lettre à Maurice Thorez, un an après l’édition définitive du Discours sur le colonialisme, où Césaire dénonce la posture du « grand frère » persuadé de savoir mieux que les autres peuples ce qui est bon pour eux — s’adresse, au fond, à la gauche humaniste européenne.
Césaire dit : « Vous, les humanistes, qu’est-ce que vous reprochez à Hitler ? » De n’avoir fait à votre continent — à vos peuples, et en premier lieu aux Juifs européens — que ce qui avait été fait auparavant ailleurs. Et tout le propos radical du Discours sur le colonialisme, c’est de dire : au bout du colonialisme, il y a Hitler. Au bout de la logique impériale — qui suppose une supériorité — il y a, une fois les oripeaux et les alibis tombés (on ne parle plus de démocratie, plus d’idéal international, plus d’ONU : tout cela s’effondre), il y a le noyau brut.
Ce noyau brut, c’est : « moi, mon peuple, ma nation, mon identité ont des droits absolus ; est juste ce qui est bon pour mon peuple ». C’est une logique hitlérienne : un impérialisme poussé jusqu’au bout. Et une autre phrase d’Hitler, au cœur de ce que disent et font aujourd’hui Netanyahou, Trump, l’extrême droite poutinienne, c’est : « l’humanité, ça n’existe pas ». « Je ne connais pas l’homme », dit-il ; l’humanité, c’est « marxiste », écrit-il, et l’individu libéral, il dit ne pas le connaître non plus : il ne connaît que le peuple, défini par la terre, l’identité, la racine.
Et l’on rejoint alors ce que Glissant a combattu : les identités racinées, au profit des identités-relation.
Nous assistons donc, aujourd’hui, à ce bout du bout. Et c’est pour cela que les dirigeants européens sont désemparés : comment défendre le droit international quand on le piétine soi-même — par exemple dans une logique de puissance autour du « Grand Israël » ? Comment le reprocher à Poutine quand on l’accepte dans la logique impériale américaine ?
Un document stratégique américain, diffusé début décembre, disait déjà tout : la prochaine cible, c’est l’Europe. Il n’y a plus d’ordre international ; il n’y a plus qu’une logique : « ce qui est bon pour moi », « je suis la première puissance militaire », « je veux être la première puissance économique, dans une logique extractiviste, court-termiste, de prédation ».
C’est ce que j’ai appelé, dans Le Jardin et la jungle il y a un an — en reprenant un terme dont je me suis aperçu qu’une écrivaine féministe, Françoise d’Eaubonne, l’avait déjà utilisé : « l’illimistisme ». L’empire que nous avons sous les yeux n’est plus l’impérialisme d’avant : c’est un empire qui ne connaît aucune limite à son désir, à sa volonté de prédation, à sa manière même de rançonner, tant il est mafieux. Et, en ce sens, au-delà de la référence au Troisième Reich pour l’idéologie, la référence historique est plutôt l’Empire romain : une logique impériale. Rome fait sa loi au monde et impose sa loi au monde. Vous pouvez être en paix si vous acceptez la loi de Rome ; sinon, vous serez détruits — Delenda Carthago.
Nous sommes donc face à un moment vital. Ce sont nos idéaux premiers — pas tous les « ismes » ajoutés, mais les idéaux humanistes élémentaires, ceux du mouvement de l’égalité — qui sont aujourd’hui remis en cause.
Leïla Cukierman : En effet, ils le disent clairement : « Bring back colonialism ». Les conseillers — enfin, les proches de Trump — expliquent très explicitement que, selon eux, la faiblesse de l’Europe, c’est d’avoir décolonisé. Ils l’écrivent, ils le disent : pour eux, la colonisation serait l’une des meilleures choses arrivées au monde, et aux peuples colonisés, à qui l’on aurait apporté « la civilisation », la “bonne société”, l’humanisme, l’universel — et l’universalisme, justement.
Edwy Plénel : Si je peux rebondir : la question coloniale est une question inachevée, pas seulement dans nos débats ordinaires. Elle est inachevée, évidemment, au cœur de certaines pensées françaises issues de la tradition républicaine née de la Révolution française. Et pas seulement chez Jules Ferry — que je cite d’ailleurs dans la préface que j’ai écrite pour mes articles sur la Palestine.
Il y a quelque chose de très frappant, parce qu’on retrouve aujourd’hui, à propos du Groenland et de l’idée de « racheter » le Groenland, un vieux réflexe impérial. Napoléon — à l’époque, il n’était pas encore Napoléon Ier, mais Premier Consul — rétablit l’esclavage en 1802 et veut reconquérir Saint-Domingue, c’est-à-dire Haïti, parce que c’était le trésor : l’équivalent du pétrole aujourd’hui. Saint-Domingue était le cœur de la richesse, l’industrie du luxe du moment — le sucre, le café, et bien d’autres produits. C’était l’accumulation primitive du capital : tous les « LVMH » de l’époque y faisaient leur fortune.
Napoléon veut donc reconquérir Haïti. Et, pour financer sa guerre, il vend la Louisiane — un territoire immense qui montait jusqu’à Chicago, jusqu’aux Grands Lacs (c’est aussi pour cela que les États-Unis ne parlent pas français). Il envoie son beau-frère, Leclerc à la tête d’une armée « républicaine ». Ce sont des hommes formés par dix ans de Révolution française ; ils connaissent la Déclaration des droits de l’homme ; ils sont franc-maçons ; ils ont gagné leurs galons au feu, etc. Et Leclerc écrit à son beau-frère, en substance : « Je n’y arrive pas. » Et, un siècle avant Conrad et Au cœur des ténèbres, il dit : « Il n’y a pas d’autre solution que de les exterminer tous : hommes, femmes et jeunes au-dessus de quatorze ans. »
Leclerc meurt ensuite de maladie. Rochambeau lui succède, abaisse encore le seuil à 7 ans et parle de « les exterminer tous ». Et Rochambeau sera défait à Vertières.
J’en reviens donc au cœur de mon propos : il faut comprendre comment nos sociétés peuvent basculer ainsi. C’est ce qui arrive à la société israélienne : des jeunes diplômés, cultivés, faisant la fête à Tel Aviv — et qui ne sont pas tous nazis, ni fascistes, ni religieux — en viennent à participer à des crimes de guerre. Comme les Einsatzgruppen l’ont fait, sous la direction de juristes diplômés, issus de très bonnes familles, en organisant la Shoah par balles.
C’est cela, la logique coloniale. Et c’est évidemment ce qui s’est passé avec la torture, avec les massacres. Nous n’avons d’ailleurs pas encore pleinement documenté tous les massacres commis pendant les guerres coloniales.
J’insiste là-dessus parce qu’il faut dénouer cette question coloniale jusqu’au bout. Et puisque nous sommes à Alternative communiste, il faut la travailler vraiment jusqu’au bout. C’est pour cela que je rappelais Césaire, son Discours, la Lettre et le congrès des écrivains noirs à la Sorbonne qui serait traité de « wokiste » aujourd’hui.
Pour terminer sur ce point : dans ce moment-là, ce que nous devons revisiter, je l’ai écrit au moment de l’invasion de l’Ukraine, c’est la rupture — au-delà des débats sur la violence révolutionnaire, sur les bolcheviks, la dissolution de la Constituante, la répression des socialistes révolutionnaires, tout ce que vous connaissez par cœur, sans doute mieux que moi.
Le moment de brisure profonde — que Lénine n’a pas eu le temps de mener à terme avant Staline — se situe, pour moi, sur la question coloniale, sur la question identitaire de l’empire. Staline, tout Géorgien qu’il soit, choisit de se comporter en « grand Russe » et fait de l’Union soviétique une puissance coloniale : une puissance qui conserve des alibis d’universalisme, derrière les idéaux originels du communisme, mais qui se traduit par l’assujettissement d’autres nations et d’autres peuples.
Et ce qui s’est joué en 2022 renvoie totalement à cela — y compris dans l’arrière-pensée : Poutine pensait y arriver en trois jours, et il n’y est pas arrivé. Ce qui l’en a empêché, ce n’est pas l’État ukrainien — corrompu —, c’est le soulèvement du peuple ukrainien : un peuple qui s’est dressé parce qu’il avait sa dynamique d’auto-organisation, son mouvement propre. C’est très bien documenté par Anna Colin Lebedev.
Et l’arrière-pensée de Poutine, c’était aussi de rétablir l’empire : la fin de l’année 2022 devait coïncider avec le centenaire de la création formelle de l’URSS, l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Donc la question coloniale — la question du « grand frère » — est centrale. Rappelez-vous l’invasion de l’Afghanistan : « nous avons les meilleures idées, eux sont obscurantistes, donc nous allons faire la police à leur place ». Et Dieu sait si ce théâtre de la guerre, et cette invasion, sont au cœur de ce qui a suivi — y compris dans le tournant de 1979.
Je dis donc cela parce que nous nous disons anticolonialistes, mais la question coloniale, il faut la travailler jusqu’au bout.
Leïla Cukierman : Et elle n’a pas été assez travaillée. Alors est-ce que l’œuvre et la pensée de Glissant peuvent nous aider à la travailler, par exemple sur la question de l’universalisme et de l’universel ?
Edwy Plénel : Oui. Et je dis ceci — même si c’est un peu « machiste », parce que c’est une trinité masculine — : je pense qu’il faut embarquer Césaire, Glissant et Fanon.
Fanon est un penseur humaniste formidable. Et cela a été un peu rappelé par les films qui sont sortis. On ne peut pas dissocier la pensée de Fanon du fait qu’il était soignant : quelqu’un qui pensait l’aliénation, avec toute la formation reçue à Saint-Alban, avec Tosquelles, et cette idée qu’il faut comprendre les logiques de supériorité — supériorité d’origine, de culture, civilisationnelle. Non seulement cela aliène celui qu’on domine, mais cela crée aussi une aliénation chez celui qui domine : on n’est plus dans la quête de l’autre, on se place au-dessus, et cela produit toutes sortes de pathologies.
Glissant, pour moi, c’est autre chose : une œuvre multiforme, moins directement inscrite dans l’action politique telle qu’elle s’est exprimée chez Fanon et Césaire, et plus ample, plus diverse. Mais, au fond, ce qu’Édouard a cherché à faire, c’est de dire : nous avons besoin de retrouver un imaginaire politique.
Nos mots ont été abîmés. Il y a un article très dérangeant, que nous avons publié sur Mediapart et laissé volontairement en accès libre, de Paolo Stephani, intellectuel latino-américain, qui revisite la situation vénézuélienne en demandant : est-ce que ce n’est pas, pour les gauches américaines, une sorte de « chute du Mur » ? Autrement dit : derrière, qu’est-ce qu’il y a ? Beaucoup de désolation. Et, du coup, des mafieux, de la violence. Pourquoi ? Parce qu’on a délaissé les questions démocratiques, délaissé la société.
C’est cela, le madurisme : derrière l’histoire de Chávez, on voit un pouvoir qui se retourne contre sa société, contre sa diversité, contre les gauches critiques, contre la presse, contre les syndicats, contre l’auto-organisation.
Donc, tout l’imaginaire de Glissant nous invite à cela. Pour moi, c’est ce que nous devons faire aujourd’hui. Je ne crois pas aux raccourcis. Il peut y avoir de bonnes surprises électorales — comme tout le monde, je peux les souhaiter — mais, même en cas de surprise, les vents sont contraires. Il nous faut donc construire un rapport de force : comment nous organisons la société, comment nous la mobilisons, comment nous retrouvons un imaginaire commun — internationaliste, humaniste — avec cette radicalité de l’égalité et cette injonction de Glissant : « Agis en ton lieu, pense avec le monde. »
Pour être concret : s’il devait y avoir une catastrophe électorale en 2027, pour moi, il y a eu une occasion manquée terrible en 2024. En 2024, ne l’oublions pas, ce ne sont pas les formations politiques de gauche qui font le sursaut au moment de la dissolution : il y a une sidération générale, tant la décision est imprévisible et impensable. C’est un outsider qui lance le mot d’ordre d’un nouveau Front populaire : François Ruffin.
Et la balle est reprise par la société, par sa dynamique, au point que des partis qui se disaient irréconciliables arrivent, en trois jours, à produire un programme de gouvernement. Au passage, certains en profitent pour régler des comptes internes, mais peu importe : ils produisent un programme commun.
Ne l’oubliez pas : les deux seuls grands rassemblements unitaires, place de la République — avant le premier tour, puis entre les deux tours — ne sont organisés par aucune organisation politique. Ce sont les médias indépendants, l’intendance de la Fête de l’Humanité, le service d’ordre de la CGT, et tout le monde associatif. C’est la société qui organise.
Et là, pour moi, l’occasion manquée, c’est précisément cela : quel est le message de Glissant ? Faire jouer la société, sa dynamique ; faire une politique de relation. Or, qu’a-t-on vu ensuite ? Les partis se mettent d’accord sur un nom de Première ministre et attendent sagement un entretien d’embauche, au lieu d’imposer un cap.
Au lieu de faire ce que Lucie Castets et les autres auraient dû faire : constituer une équipe, un gouvernement prêt, un « shadow cabinet », parler à la société plutôt qu’à Macron. Montrer qu’on a des réponses : quelqu’un sur l’éducation, quelqu’un sur l’international, quelqu’un sur les solidarités, quelqu’un sur la santé, quelqu’un sur l’habitat — une équipe, et pas uniquement composée des partis et de leurs représentants.
Et puis appeler la société à créer partout des comités du Nouveau Front populaire, où tout le monde serait à égalité.
Aucune des forces politiques n’a voulu cela — et je ne vise pas seulement La France insoumise et le Parti socialiste, qui entretiennent volontiers leur division, chacun avec ses arguments : aucune formation n’a souhaité organiser ce mouvement dans la société. On est resté dans l’entre-soi, dans la logique « on reprend la main ». Pourquoi ?
Je viens de terminer un petit libelle — probablement pour provoquer le débat, j’espère — qui sort en mars et s’intitule La démocratie n’est pas l’élection. Il porte sur cette idée : depuis trente on en est arrivé à oublier ce qu’est la base de la gauche, son lieu.
La gauche, ce ne sont pas les institutions. Ce n’est pas l’État. Ce n’est pas l’Assemblée, ni la présidence de la République. Ce n’est pas la prise du palais de l’Élysée comme d’autres rêvaient de prendre le palais d’Hiver. La gauche, c’est la société : l’organisation de la société. C’est, au départ, le mouvement syndical, et toute cette exigence venue d’en bas.
Depuis quarante ans — et c’est notre désolation — l’absolutisme électoral (pas seulement présidentiel) a fait que les formations se sont transformées. Dans les années 1970, et encore dans les années 1980, on voyait une diversité sociale, une diversité de métiers, une diversité de militants. Puis tout s’est resserré : pas forcément avec des gens moins « bien », mais avec une professionnalisation et un rétrécissement autour de la seule question électorale — surtout au niveau national.
Et je termine sur un dernier point : derrière tout cela, il y a une sous-estimation de la question démocratique.
Je suis sidéré, quand je vois comment se comporte Trump, de constater notre solitude — nous, juges et journalistes — face aux forces politiques de gauche, sur ces sujets. Trump veut mettre au pas la justice, lui qui est un repris de justice ; il veut mettre au pas la presse pour que son récit l’emporte. Mais regardez notre isolement, notamment depuis deux décennies.
Je suis frappé par le fait que, au lieu de dire : « l’éthique en politique est une question politique, pas une morale abstraite », au lieu de s’engager pleinement sur la probité, sur l’indépendance de la justice, sur la liberté de la presse, on laisse ces sujets de côté.
On a des choses à dire sur Sarkozy ; on a des choses à dire sur les assistants du Front national ; on a des choses à dire sur la probité des fonctions publiques. Et une justice indépendante, même quand elle nous cherche des noises, c’est vital. Une presse libre, même quand elle révèle des choses contre nous, c’est vital.
Cela peut paraître anecdotique, mais deux responsables politiques ont employé la même insulte contre Mediapart en disant que nous étions « un torchon » : l’un l’a écrit dans un billet de blog, l’autre l’a dit à son procès. Il s’agit de Jean-Luc Mélenchon et de Nicolas Sarkozy. Et pour moi, c’est sidérant.
On a le droit d’être furieux contre un journal. On a le droit d’être agacé par des juges — qu’ils jugent Mme Chikirou, comme ils doivent juger Mme Dati : nous sommes d’ailleurs en pleine campagne municipale à Paris. Mais on ne peut pas saper cette culture démocratique. On ne peut pas considérer que la question démocratique n’est pas au cœur de ce que nous défendons.
Leïla Cukierman : J’ai une question quand même sur la question de l’universalisme parce que c’est quelque chose qui comme le colonialisme n’a pas été une question travaillée. Je trouve que les communistes se sont alignés sur cette idée d’universalisme. Or Glissant le dénonce…
Edwy Plénel : Oui. Édouard détestait ce mot. Il disait : l’« universalisme », en le prononçant, c’est déjà une façon de s’en déclarer propriétaire. En réalité, l’universel n’appartient à aucune civilisation. Il se construit dans la relation, dans le lien à l’autre. Chaque culture porte des dimensions de partage et d’égalité.
Et l’on en revient toujours à une question décisive, parce qu’elle emboîte toutes les autres : la question de l’égalité — l’égalité naturelle — comme moteur de l’émancipation.
Ce n’est pas un hasard si je vous ai parlé tout à l’heure de l’illimitisme. Trump est un prédateur — y compris sexuel. La prédation extractiviste, financière, la rançon économique, vont de pair avec la prédation des corps. Le mouvement #MeToo nous l’a rappelé : les violences sexistes et sexuelles n’ont pas de frontières idéologiques ou sociales. On est là au cœur d’une question anthropologique : le rapport à la domination, le rapport à la puissance — et, derrière cela, la puissance de notre espèce.
Nous ne sommes qu’une toute petite partie du vivant. Mais nous avons un gros cerveau, qui fait de nous des prématurés : autrement, nous ne pourrions pas naître. C’est aussi pour cela que nous ne gambadons pas comme des poulains, à peine sortis du ventre de celle qui nous met au monde. Et cette puissance créative immense est aussi une puissance destructrice terrible.
Nous sommes donc au cœur de quelque chose qui, pour moi, exige de retrouver un imaginaire. Il y a eu, dans le socialisme et le communisme, des logiques de puissance, des logiques de force, des logiques d’histoire « écrite » — dominatrices.
Non : l’histoire n’est pas écrite. Elle est faite de bifurcations. Mais surtout, aujourd’hui, dans ce moment de crise de civilisation, notre imaginaire doit être un imaginaire de précaution : comprendre la fragilité du monde dans lequel nous vivons. L’imaginaire de la force et de la puissance, c’est le leur : c’est celui de nos adversaires.
On fait fausse route en répondant à cet imaginaire par un imaginaire équivalent — en disant « il faut une Europe puissante, il faut être puissant », comme si c’était la réponse —, c’est courir à l’échec. Il faut une autre grandeur.
Pour moi, j’ai compris — indépendamment de leurs erreurs sur la Palestine et sur bien d’autres sujets — que Kamala Harris et les démocrates allaient perdre quand, lors d’un grand rassemblement à l’été 2024, où l’on voyait d’ailleurs AOC et Bernie Sanders venir les soutenir (parce que la politique de Biden avait été plus sociale que celle d’Obama ou de Clinton), elle a terminé sur cette phrase, pour galvaniser : « We are the greatest nation on earth » — « nous sommes la plus grande nation sur Terre ».
Comment voulez-vous vous opposer au MAGA, au « grand Empire », à la « grande Russie », au « grand Israël », si vous restez dans le même imaginaire ? Vous pourrez multiplier les « grands » que vous voulez : si vous avez le même imaginaire, vous perdez.
Et là, on revient à la longue durée des débats de l’émancipation. Édouard était un enfant de cela. Dans les années 1950-1960, il était plutôt lié à un courant qu’on pourrait appeler une opposition de gauche critique : un courant qui posait davantage la question démocratique, la question internationaliste, et le risque qu’au fond, l’émancipation reproduise la domination — qu’elle lui ressemble, qu’elle retombe dans une logique de puissance, donc d’exclusion. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé, souvent, dans les indépendances.
Et là, il y a un mot qu’il faut retrouver : le mot « libertaire ». Je pense que nous avons perdu en route quelque chose qui a été au cœur du mouvement ouvrier du XIXe siècle, au cœur de la Commune de Paris, au cœur de la naissance de la CGT, au cœur de nombreux itinéraires — même Aristide Briand, figure ensuite parlementaire, a été dix ans militant libertaire, au cœur des batailles de l’affaire Dreyfus. Ce sont les libertaires qui ont fini par ramener Jaurès, et ramener Zola. C’est ce nouvel imaginaire qui nous oblige.
Oui, il y a « le feu au lac », on est d’accord. Mais si le feu est au lac, je dois d’autant plus me méfier de l’obsession du pouvoir, de l’obsession de sa conquête, sans poser ce que je disais tout à l’heure : la mobilisation de la société — pas son instrumentalisation, son autonomie, son auto-organisation. Elle a son agenda propre : je me contente de soutenir, je n’instrumentalise pas, je n’agis pas à sa place.
La radicalité démocratique, c’est d’autant plus essentiel qu’en face, ce sont des adversaires de la démocratie.
Curtis Yarvin — idéologue totalement « schtarbé » du monde trumpien — théorise très explicitement cet illimitisme et cette violence. Dans un entretien (je crois que c’était au Grand Continent), il dit en substance : « Trump a compris : j’entre dans la pièce, je dis ‘je le veux’, ‘c’est à moi’, et ça marche. Donc il n’y a aucune raison de s’arrêter. » Yarvin dit à Trump : « Ne t’arrête pas en si bon chemin. Je veux rester au pouvoir. » Il commence à parler de monarchie — pas une monarchie parlementaire, non : la durée éternelle du pouvoir.
Et évidemment, ils vont s’attaquer — ils ont déjà commencé — à toutes nos conquêtes démocratiques, petites, fragiles, souvent difficiles à défendre : la justice indépendante, le contrôle de la police, le contrôle des administrations, la liberté de la presse, sa diversité, sa pluralité.
Et pour montrer la longue durée des défaites sur ces questions, Sylvie Laurent — parce que tout cela est trop peu partagé dans les débats à gauche — explique, dans un petit livre très utile sur les illusions autour de la Silicon Valley : pourquoi basculent-ils ? Parce qu’ils sont du côté de leur pouvoir financier. Tant que les démocrates les protègent, ça leur va. Mais à partir du moment où, sous l’administration Biden, la question des monopoles et de leur démantèlement commence à émerger, ils prennent peur : ils veulent garder l’oligopole, ils ne veulent pas être démembrés. Alors ils se tournent vers celui qui leur dit : « Vous resterez des barons voleurs », dans la longue histoire américaine, de Rockefeller et des autres : « on ne vous démembre pas ».
Mais n’oubliez pas que la non-régulation d’Internet à l’échelle mondiale — parce que l’industrie était américaine —, l’idée même qu’« il n’y aura pas de règles, pas de régulation », c’est Clinton : un président démocrate.
Deuxièmement, quand vous pensez à Starlink, et à toutes les capacités de surveillance au-dessus de nos têtes contrôlées par le fasciste Elon Musk — celui qui a ouvert au privé la conquête spatiale, avec un imaginaire suprémaciste, survivaliste (« nous, les privilégiés, sur Mars ; le reste peut mourir ») —, celui qui a ouvert cette porte, c’est Obama. Autrement dit : deux présidents « de gauche » américaine ont, en réalité, lâché les freins. Ils ont renoncé à réguler, à se dresser.
Et vous voyez bien qu’on en revient à ce que fut le quinquennat Hollande. À part le sursaut du parquet financier, provoqué par les révélations de Mediapart, sur la presse et les médias : rien. Le groupe Bolloré n’existait pas encore sous la forme actuelle au moment du quinquennat Hollande. Tout était sur la table. Toutes les propositions de régulation des médias étaient sur la table.
Nous, au syndicat de la presse indépendante d’information en ligne, nous avons fait un manifeste. Nous l’avons déposé à l’automne 2012. Nous avons eu des débats avec ceux qu’on appellera plus tard « les frondeurs » sur l’urgence de ces questions. Rien n’a été fait. Rien n’a été fait.
Et vous voyez le résultat aujourd’hui.
Leïla Cukierman : Il y a une question que je voulais vous poser, et qui porte sur les imaginaires. Glissant dit : « Nul imaginaire n’aide réellement à prévenir la misère, à s’opposer aux oppressions, à soutenir ceux qui supportent dans leur corps ou dans leur esprit. Mais l’imaginaire modifie les mentalités si lentement qu’il en aille ».
Tout à l’heure, vous parliez justement de l’imaginaire, et vous parliez aussi du langage. Est-ce que vous pensez que la gauche manque de cela ? Je pense en particulier au Parti communiste, dont je suis proche : est-ce qu’il manque d’un imaginaire, d’un travail sur les mots, sur le langage ?
Edwy Plénel : S’il y a bien une chose que je ne voudrais jamais faire, c’est donner des leçons à celles et ceux qui sont engagés. J’ai repris la formule d’Édouard : « Agis en ton lieu et pense avec le monde ». Mon lieu, c’est le journalisme. J’en rends compte. Je suis ouvert à la critique là-dessus, mais je ne vais pas distribuer des bons points.
Je parle simplement de ce qui, à mes yeux, pose problème. Et je vais être très concret, parce que, dans certains débats, on entend : « Cette histoire d’imaginaire, c’est abstrait. Tu es loin de nos combats concrets, loin de nos luttes immédiates. »
J’ai une réponse très simple, élémentaire : à l’été 1789, sur fond de lectures de Jean-Jacques Rousseau, on proclame l’égalité naturelle. Or, à ce moment-là, il n’y a aucun droit. Aucun droit politique, aucun droit social. Il n’y a pas de droits des femmes. Il y a l’esclavage. Il y a le travail des enfants. Vous pouvez multiplier les exemples : il n’y a aucun droit.
Un imaginaire, c’est cela : un horizon. Quand vous partez en randonnée, vous vous dites : « Je vais faire du dénivelé, je vais monter le plus haut possible, et là je verrai l’horizon. Je ne l’atteindrai pas, mais ça m’aura fait du bien. » Et on s’est soulevés, on s’est réveillés, on s’est organisés pour cela.
La proclamation de l’égalité naturelle a été le moteur de l’émancipation, y compris en se retournant contre ceux qui l’avaient proclamée et qui la piétinaient. C’est pour cela que la question du colonialisme et de l’esclavage a été essentielle. C’est pour cela que la question sociale, au-delà des seuls droits politiques, est devenue essentielle.
Au XIXe siècle, il y a le Manifeste des Soixante, écrit par un membre de la Première Internationale — celle de Marx et de Bakounine. Il s’adresse à ce qu’on appelle alors « la gauche » : des avocats, des journalistes, des médecins. Et il dit, en substance : « Non. Nous voulons être représentés par nous-mêmes. Nous voulons nous sauver nous-mêmes. » Ce manifeste est essentiel pour construire une auto-organisation ouvrière.
J’ai évoqué tout à l’heure la cause des femmes : elle est infinie de ce point de vue. Elle bouscule sans cesse, elle ouvre de nouveaux horizons de droits, et elle nous oblige à bouger.
La question écologique, évidemment, est du même ordre — y compris dans nos propres références. On a besoin d’électricité aujourd’hui ; on a des camarades à EDF, dans les centrales nucléaires. Et pourtant, tout à coup, on commence à penser autrement : c’est aussi une question d’égalité des droits. Nous, espèce immensément minoritaire mais immensément dominante, nous n’avons pas un droit absolu sur le vivant. Nous n’avons pas tous les droits. Nous ne sommes pas dans l’illimitisme.
Et c’est là qu’il faut revenir à une pédagogie de fond : la culture démocratique, c’est une culture des limites. Des limites. C’est même inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme : j’ai des droits, mais je ne peux pas en abuser au point de violer ceux des autres. Vivre en société, c’est accepter des limites, accepter des règles, et construire ensemble ces limites.
Quand on parle d’Édouard Glissant, on parle d’un foisonnement d’idées — et cela parle beaucoup aujourd’hui. Son œuvre est très mobilisée par les artistes : il y a, par exemple, une grande exposition au Brésil. Dans ce moment de désolation, les artistes y retrouvent une source d’inspiration. Et puis le monde entier s’en empare. Felwine Sarr, le philosophe sénégalais — j’ai fait une émission avec lui — parle de Glissant à sa manière. Pour lui, la pensée de Glissant est une évidence : elle est au cœur d’une vision du monde issu des dominations, qui cherche à les subvertir sans les imiter, sans les reproduire. C’est l’avertissement de Fanon, à la fin des Damnés de la terre : ne pas reproduire ce qu’on combat.
Cette œuvre n’est pas terminée. Ce message, Édouard Glissant l’a repris. Et aujourd’hui, c’est cette œuvre qu’on doit refonder.
Toutes ces idées existent. Elles sont là, un peu partout, en jachère. Le problème, c’est que les formes de traduction politique ont été ramenées à une verticalité : la verticalité de la conquête électorale du pouvoir.
Vous me posez la question du Parti communiste, mais je pourrais dire la même chose — dans toutes leurs variantes — pour toutes les formations de gauche. Tout cela existe : vous connaissez ces œuvres, vous les lisez, vous les partagez. À La France insoumise, j’imagine que c’est pareil — avec l’Institut La Boétie. Chez les écologistes aussi. Et j’espère même chez quelques socialistes.
Mais le problème, c’est l’organisation politique réduite à la conquête du pouvoir.
Et là, on est au cœur d’un débat légitime sur l’organisation de La France insoumise : il est légitime d’interpeller la force hégémonique à gauche aujourd’hui. Elle a une pratique totalement ordonnée à sa conquête du pouvoir — pas à la construction d’une digue, comme dit Pouria Amirshahi, pas à la construction d’un rapport de force dans la société — uniquement à sa conquête du pouvoir.
À mon avis, c’est ne pas tirer les leçons de ce qui nous est arrivé.
C’est aussi pour cela que nous avons souvent des désaccords avec certaines prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur l’international : sur la brutalité des sociétés, et sur cette manière de ne regarder les questions internationales qu’à travers les États, en ignorant les peuples. Ignorer le peuple syrien. Ne pas comprendre qu’il y a un peuple ukrainien — et que ce n’est pas seulement une histoire d’OTAN face à Poutine. Ne pas comprendre ce qui s’est passé au Venezuela.
Ce qui s’est passé au Venezuela, c’est — qu’on soit bien d’accord — un coup d’État, une violation totale du droit international, un acte immensément grave. Et ce n’est que le début de ce que Trump est capable de faire : c’est la logique perverse de ces pouvoirs. Trump s’adresse toujours là où il y a un point faible : là où des pouvoirs ont perdu leur peuple. La plus grande immigration sans guerre de ces dernières années, après la Syrie, c’est le Venezuela. Le pays dont le plus grand nombre de personnes sont parties — en dehors de la Syrie et de la dictature d’Assad —, c’est le Venezuela.
Ce sont donc des questions qu’on ne peut pas évacuer. Il faut tenir tous les bouts, dans ce moment où il faut construire une résistance. Il faut accepter cette idée : on construit d’abord un rapport de force.
Bien sûr, s’il y a des surprises heureuses — tant qu’on peut voter, tant qu’il y a encore la possibilité d’utiliser le bulletin de vote pour éviter le pire — faisons-le. Mais cela ne suffira pas à nous protéger.
Leïla Cukierman : Avant de passer la parole à l’assemblée, j’aurais deux questions, toujours autour des imaginaires, que j’aimerais qu’on précise — assez vite, si possible — parce que je pense que cela fait partie de ce que nous aurons à travailler.
La première, c’est la créolisation : qu’est-ce que Glissant entend par là ?
La seconde, c’est la mondialité, qui est aussi un des concepts centraux chez Glissant et qui pourrait peut-être nous aider à faire face à cette vague brune, à cette prédation générale.
Et, justement, sur la créolisation : vous évoquiez Mélenchon, qui en a fait un slogan. Et moi, ça m’a beaucoup gênée, parce que ça ne peut pas être un slogan. Et en plus, c’était confus : on mélangeait la créolisation avec le métissage — et, déjà, il y avait une confusion avec la créolité. J’aimerais qu’on s’éclaire là-dessus.
Edwy Plénel : Non, non : bien vu, bien vu. C’est exactement ça.
La créolisation… Il y a une phrase de Glissant — je cite de mémoire — qui résume assez bien ce qu’il veut dire : « Je change, et changeant avec l’autre, sans me perdre ni me dénaturer pour autant ».
C’est cette idée que nous sommes tous faits des autres, tous faits de relation. La créolisation, en ce sens, c’est un imaginaire. Cela n’a rien à voir avec une fixité.
C’est pour cela que ce n’est pas : « on se métisse, on se mélange », deux identités qui produiraient une troisième identité stable, comme dans l’idée classique de métissage. Non : la créolisation, c’est un mouvement permanent. Un mouvement permanent qui suppose qu’on se remet en cause, qu’on bouge.
Pour moi, le synonyme de l’émancipation — avec le moteur de l’égalité — c’est le déplacement.
Et qui sont nos adversaires, les conservateurs ? Ce sont ceux qui veulent nous immobiliser : immobiliser nos sociétés dans une identité décrétée, figée. Et, de ce point de vue, l’origine ne protège de rien. Il peut toujours y avoir la tentation de dire : « Voilà, je m’arrête, j’y suis. » C’est la dialectique du paria et du parvenu : « je suis arrivé, je ferme la porte, et les autres n’ont plus le droit d’entrer ». Le mouvement s’arrête.
Cela traverse même les sociétés post-indépendance, en Afrique, où existent des idéologies de la fixité identitaire, parfois dressées contre le colonialisme ou le néocolonialisme français.
Donc la créolisation, c’est un mouvement : un imaginaire de société imbriquée, une société faite du monde. Et, pour nous, militants progressistes, cela renvoie à des questions très concrètes : l’hospitalité, la place de l’autre, et la situation de ceux qu’on appelle les « migrants », c’est-à-dire ceux qui exercent ce droit au déplacement, le droit à un nouvel horizon, le droit à de nouvelles espérances.
On le sait d’ailleurs, dans ce qui est documenté sur les chercheurs de refuge : ce ne sont pas forcément les plus pauvres, ni les plus misérables. Et, au fond, le mouvement de nos sociétés s’est toujours fait comme cela.
On pourrait même dire que la créolisation, c’est aussi ce mouvement historique par lequel, avec le chemin de fer, on est sorti de la fixité du village : on a commencé à sortir des lignées, à se rencontrer, à se marier autrement, à découvrir d’autres univers, d’autres mondes.
Et cela renvoie aussi à un lien au vivant. Glissant prend souvent l’image des palétuviers, au bord des mangroves. Cet arbre est très particulier : il fait des branches qui sont aussi des racines, et ces racines font que l’arbre bouge. C’est un arbre qui bouge : ses bras deviennent des jambes, et ces jambes le déplacent. Voilà l’idée : la créolisation, c’est refuser de dire « il y a les identités closes, les suprémacismes identitaires, et moi j’aurais une identité alternative, le métissage ». Non : il y a un mouvement permanent. Et encore une fois, l’origine ne protège de rien.
Nous sommes dans cette dynamique tout le temps. Elle peut se faire dans notre chambre, dans notre cerveau, dans les mots que nous employons. Dans son dernier livre — La Terre, le feu, l’eau et les vents — qui est un recueil de textes (et pas seulement poétiques : des discours, des fragments, des phrases), Glissant était déjà dans ce mouvement. Il savait que ses jours étaient comptés. Et ce livre, c’est aussi cela : un mouvement. Pour moi, c’est le mouvement historique profond : une dynamique permanente de l’émancipation.
Quant à la mondialité, c’est un peu la même logique : trouver un mot face à une vision économiste de la mondialisation, centrée sur l’économie. Oui, notre monde est unifié aujourd’hui. Les jeunes en Afrique nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Ils nous voient, ils nous observent, ils nous comprennent parfois mieux — et ils nous blaguent.
J’ai fait une émission avec Souleymane Bachir Diagne — l’aîné de Felwine Sarr. C’est l’une des vidéos les plus regardées… mais ce n’est pas en France : c’est en Afrique. Cela dit quelque chose.
Et pendant ce temps, ici, on se ferme : on voudrait nous enfermer dans des cases, dans des écrans, dans des dispositifs d’intoxication.
Donc la mondialité, c’est dire : oui, nous avons fait le « Tout-Monde », ce que Glissant appelle le Tout-Monde — lié au Tout-Vivant. Nous sommes dans ce Tout-Monde. Mais, encore une fois, son message principal, c’est celui-ci : nous vivons la catastrophe de la puissance.
Les logiques de puissance enfantent Trump, enfantent Poutine, enfantent Netanyahou, enfantent Modi, etc. Ils vont se partager le monde comme des gangs mafieux, parce que c’est un monde mafieux, de la prédation, du vol, du mensonge, de l’imposture. Voilà la catastrophe de la puissance. Et donc, sans être naïfs, en s’organisant, en régulant, en ayant aussi une puissance étatique capable de s’opposer à cela — ce qui n’a pas été fait, ce qui est un retard sinistre —, il faut comprendre que c’est bien notre adversaire.
Je me suis infligé la conférence de presse d’hier sur l’Ukraine : c’est terrible. Vous savez, dans le document sur Gaza, il est déjà écrit que Trump serait le président du comité de « paix ». On ne sait pas comment ce sera conçu, mais c’est écrit — et, en l’occurrence, cette « paix », c’est la guerre.
Dans le document sur l’Ukraine, il est écrit, y compris dans un texte accepté par les Ukrainiens, que Trump serait le président du comité de « paix ». Et hier, alors qu’on est en pleine crise sur le Groenland, ils disent : « Tout cela sera d’abord sous hégémonie nord-américaine. »
Donc certains n’ont pas compris : c’est notre adversaire.
Soit nous continuons à défendre ce qui a produit la Déclaration universelle des droits humains en 1948, les Nations unies, et tout ce qui en a découlé — droits sociaux, ONG, contre-pouvoirs, justice internationale —, soit nous renonçons. Mais, dans le premier cas, l’ennemi — qui a Poutine comme allié — s’appelle Trump. Ce ne peut pas être notre allié.
Et il serait temps de le voir.
Alors attention : ce n’est pas un hasard si je parle de « catastrophe de la puissance » — c’est aussi une pierre dans le jardin de quelqu’un dont j’estime qu’il parle très fortement aujourd’hui des questions internationales, même s’il le fait dans un autre registre : Dominique de Villepin. Comme vous le savez, il a une certaine fascination pour Napoléon. Or l’expression « la catastrophe de la puissance » se trouve dans un essai d’André Suarès sur Napoléon, en 1933. Suarès compare Napoléon à Don Juan : l’appétit de conquête sans limite, sans limite. Et il dit : « Voilà la catastrophe de la puissance. »
Trump est le produit de cette histoire-là — qui est aussi la nôtre.
Napoléon, enrobé d’idéaux, porté par le souffle de la Révolution, a pourtant été un oppresseur, un esclavagiste, un ennemi majeur de la liberté de la presse. Et néanmoins, son tombeau est ici, à Paris, et les promotions de Saint-Cyr vont chanter devant lui.
Patrice Leclerc : Il y a deux messages — deux questions ou avis — dans le chat.
- « Ne faudrait-il pas commencer par reprendre possession de nos moyens de paiement, de communication, d’information ? Ne sommes-nous pas déjà complètement dépendants des États-Unis ? »
- Bozena : « Nos organisations politiques n’ont-elles pas à réfléchir davantage à leurs propres pratiques et à leurs actions, qui devraient elles aussi s’inspirer et montrer l’exemple de ce que devrait être une politique de la relation ? »
Edwy Plénel : Sur le premier point : oui, c’est tout à fait juste. J’ai évoqué tout à l’heure les défaites anticipées de la non-régulation aux États-Unis face aux géants de la tech. Mais il y a aussi un épisode franco-européen qu’on a regardé avec beaucoup trop d’indifférence.
Thierry Breton est un homme de droite, il a gouverné avec la droite. Mais sur ces questions-là, il avait compris beaucoup de choses : il vient du monde industriel, il est ingénieur, il a travaillé sur ces sujets. Et en tant que commissaire européen, c’est lui qui a été en pointe dans la bataille pour la régulation du numérique — les “Digital Acts”, y compris sur la question de l’information. Il n’était pas seulement spectateur : il avait compris la puissance destructrice en jeu.
Quand il a conçu tout cela — alors même qu’on ne peut pas dire que Mediapart soit au cœur des enjeux institutionnels de l’Union européenne — il est venu passer une demi-journée chez nous, avec ses collaborateurs, pour écouter ce que nous avions à dire : nous, qui venons du monde numérique. À l’époque, Trump n’était pas encore élu.
Et quand Ursula von der Leyen redevient présidente de la Commission, Macron lâche Thierry Breton en rase campagne. Il lâche le commissaire qui avait tout compris, et qui était déjà la cible de ces gens-là.
Et regardez : tout le monde devrait se mobiliser. Ce n’est pas “aussi grave”, en termes de conséquences immédiates, que ce qui arrive à un juge français à la Cour pénale internationale — qui, lui, ne peut plus utiliser de cartes de crédit, ne peut plus acheter sur Amazon ou ailleurs : il est banni de ce qui fait notre quotidien. Mais Thierry Breton, lui aussi, est interdit d’entrée aux États-Unis. Et les quatre autres personnes visées en même temps que lui, ce sont des ONG, c’est la société civile qui se battait sur les fake news, sur toutes ces agressions — nord-américaines comme poutiniennes — autour des manœuvres d’intoxication, de ce qu’on vit déjà, ou de ce qu’on va vivre encore plus sur nos campagnes électorales et notre vie publique.
Donc oui : c’est une question prioritaire, essentielle. Et là, il faut le dire : la présidence Hollande n’a pas fait le travail. C’est un effondrement. Pourtant tout cela a été diagnostiqué depuis longtemps.
Je rappelle d’ailleurs — je ne sais pas s’il y a ici des parlementaires — qu’au quinquennat Hollande, il y a eu un député socialiste, plutôt proche des frondeurs, de bonne volonté, Christian Paul, qui était passionné par ces questions. En 2015-2016, il a mis en place une commission de réflexion totalement inédite, paritaire : députés et société civile. Côté société civile, c’étaient surtout des juristes et des économistes, sauf deux outsiders : Philippe Aigrain — qui nous a quittés —, l’un des animateurs de La Quadrature du Net, et moi, comme seul journaliste.
Avec Philippe, nous avons été les plus assidus. Cela a donné un rapport, adopté parce que nous avons pris le temps — et c’était pourtant la pire année, 2015, celle des attentats. Nous avons enchaîné les discussions, les réunions ; il y avait même Franck Riester dans cette commission. Le rapport a été adopté à l’unanimité. Il s’appelle Un nouvel âge démocratique. Il est dans les tiroirs de l’Assemblée : c’est un gros rapport. On y posait toutes ces questions : qu’est-ce que le droit de savoir et la liberté de dire à l’âge du numérique ? Tout cela a été totalement ignoré par les états-majors. Remis en 2016, puis on passe à la présidentielle : on oublie.
Tout ça pour dire que ces questions sont posées depuis longtemps. Et il y a parfois des individus qui se révèlent. J’ai parlé de Villepin tout à l’heure : indéniablement, il est au rendez-vous sur les questions internationales — et il ne faut pas barguigner là-dessus. On a vu tant de figures de gauche passer du côté obscur qu’il ne faut pas hésiter, aujourd’hui, à dialoguer avec des personnes qui, sur l’essentiel, sont au rendez-vous des causes communes.
Et Thierry Breton est un exemple très clair : sur la question que vous posez, c’était celui qui menait l’offensive. Et la France, son pays, l’a largué en rase campagne.
Sur la deuxième question : là, c’est à vous de me dire, sur les formations politiques — vous en êtes plus témoins que moi. Mais je vais parler d’une formation différente de celle présente ici.
J’ai été frappé, au début de Mediapart : c’était le moment d’ascension très forte des écologistes, avec Cécile Duflot, Jean-Vincent Placé et d’autres, et leur dialogue avec le Parti socialiste. Aux universités d’été, il y avait parfois 1 500 personnes : une dynamique qui profitait aux écologistes, y compris dans les résultats électoraux.
C’est aussi le moment — un peu comme La France insoumise l’a reproduit ensuite — où des gens de la société civile rejoignent la formation : Yannick Jadot venant de Greenpeace, Eva Joly venant de la justice, Emmanuelle Cosse venant d’Act Up. J’en ai parlé avec des amis qui avaient rejoint ce mouvement sans être dans une logique de pouvoir, et qui en ont accompagné l’élan… avant d’en être désespérés.
Parce que, même chez les écologistes, ce qui a repris le dessus, c’est la logique électorale : un parti d’élus, de collaborateurs d’élus, ou d’apprentis élus. Et l’idée de se dire : « Non, on va faire un parti de masse ; on a une dynamique liée à des enjeux concrets ; donnons-nous les moyens de construire un parti de masse », cette idée n’a pas été menée jusqu’au bout.
Ils auraient pu faire ce que, à d’autres époques, le Parti communiste a su faire dans une autre histoire : oui, avec des élus, notamment municipaux — parce que le terrain municipal, c’est le plus proche d’un terrain commun —, mais en construisant d’abord avec la société. Même les écologistes n’ont pas su faire cela.
D’où ce surnom, “la Firme”, qui a circulé dans leurs débats internes, et toutes les crises qu’ils ont connues depuis.
Je le dis franchement : il y avait là une occasion de créer quelque chose de durable. Au lieu de quoi, on se retrouve avec des trajectoires très classiques : « j’ai un mandat au Parlement européen, comment je passe à un mandat de sénateur ? puis de sénateur à député ? », etc.
Très bien : si cela produit des vies d’engagement par le mandat électoral, je ne fais pas la morale. Je dis simplement qu’il vaudrait mieux avoir des organisations de masse, qui organisent la société et travaillent au contact de la société.
Patrice Leclerc : Sur ce que tu dis — et je partage ce que tu dis sur l’enjeu politique, notamment pour les organisations : il faudrait des organisations de masse — mais tu le dis, ou tu le penses sans doute, ce n’est pas une organisation de masse pour gagner des élections. C’est peut-être une organisation de masse pour autogérer la société et construire des formes nouvelles.
Est-ce qu’il n’y a pas chez toi une pensée qui se rapproche de ce que j’ai lu chez Murray Bookchin — qui a influencé des La France Insoumise récemment, et qui m’influence pas mal dans ma réflexion sur le communalisme libertaire ? J’ai le sentiment qu’on a eu un problème en « assassinant » les anarchistes qui sommeillaient en nous — ou qui sont, historiquement, nos frères — dans la construction d’une pensée révolutionnaire.
Et j’ai l’impression que cette pensée, dont on parle moins (alors qu’on a beaucoup parlé de Glissant et d’autres), est en train de remonter. Ou alors c’est mon prisme. Mais elle existe chez les Kurdes, elle existe à l’international. Il y a quelque chose là, me semble-t-il, d’intéressant à travailler.
Edwy Plénel : Oui. Il faut affronter la question que tu poses.
Vous avez un camarade que vous avez croisé, je pense — un camarade de parti qui vit à Saint-Denis — Alain Bertho, qui travaille aussi ces questions. Lui suit tous les mouvements sociaux, toutes les révoltes, partout dans le monde. Il les documente sur son site. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a en permanence des soulèvements. C’est comme des vagues qui n’arrêtent pas de frapper la falaise : il y a toujours des mouvements, et il y en aura toujours.
Le problème, c’est que la falaise, non seulement tient bon, mais qu’elle s’est consolidée, qu’elle s’est bunkerisée ces derniers temps.
Du coup, la question posée, au fond, c’est la suivante : face à l’épuisement de ces mouvements sociaux, soit on conclut : « on perd notre temps à se disperser dans les luttes, il faut tout ordonner à la conquête du pouvoir — et en l’occurrence du pouvoir électoral ». Soit on se dit — et dans une pensée moins binaire, à mon avis — : « on doit d’abord construire le rapport de force dans et avec la société, sur des questions concrètes ».
C’est en ce sens que, quand je critique l’obsession électorale, je vise surtout les mandats nationaux. Je distingue cela — même si, évidemment, il peut y avoir des problèmes éthiques, des problèmes de contrôle des élus, de division, parfois d’amoralisme — l’histoire de Saint-Étienne est sidérante de ce point de vue, on n’aurait jamais osé l’inventer. Mais ce que je veux dire, c’est : comment crée-t-on du commun ?
D’où ce mot, « commun », qui renvoie au terme anglais commons : les communs. Il faut se rappeler que, quand Marx reprend l’idée communiste, il s’inscrit aussi dans cette longue tradition : qu’est-ce qui est commun ? L’eau, la terre, le vivant. Et c’est de là que vient l’idéal de la Commune, comme premier lieu d’invention du pouvoir.
Et c’est cela que nous avons perdu en route, après un long détour : cette obsession stratégique du pouvoir — dans une version électoraliste, ou dans une version bolchevique — où tout est ordonné à conquérir le pouvoir, puis à le garder. Et du coup, on perd la société en chemin, et cela produit les catastrophes que vous connaissez. C’est d’ailleurs l’un des drames de la révolution russe : Lénine écrit L’État et la révolution, qui est peut-être son livre le plus libertaire, tant il critique le pouvoir d’État. Et, en réalité, c’est l’inverse qui se produit : un renforcement de l’État, sur les décombres — et en partie en recyclant des morceaux de l’ancien État.
Tu citais les anarchistes : mais n’oublie pas cette formule — je ne sais plus si Marx était encore vivant ou si c’est Engels — à propos des parlementaires de la social-démocratie allemande : le « crétinisme parlementaire ». J’ai repris l’expression en parlant du « crétinisme présidentiel » français : une fois élus, on le voit bien, cela les rend encore plus bête que nature. Cette formule ne veut pas dire qu’ils sont “bêtes”. Elle veut dire qu’ils s’enferment dans le jeu parlementaire comme si c’était le nec plus ultra de l’action, en oubliant le lien à la société, la mobilisation de la société, et surtout — comme tu l’as dit — l’autonomie de la société.
Et de ce point de vue, s’il y a une bonne nouvelle, c’est, par exemple, Zohran Mamdani.
Mamdani vient de cette longue histoire qui a donné naissance aux Democratic Socialists of America, créés au début des années 1980. Après beaucoup de sectarisme dans les gauches, et parfois des passages du côté obscur, une des organisations trotskistes aux États-Unis est devenue totalement “campiste”, alignée sur Cuba et l’URSS, et a oublié beaucoup de choses en chemin.
Mais, justement, ce qui a un temps sauvé en partie le monde, c’est une pensée radicalement démocratique dans la gauche américaine, et qui n’est pas seulement la tradition libertaire/anarchiste. Il y a aussi toute une pensée, très peu partagée en France, traduite tardivement : celle qu’on appelle les pragmatistes. Et parmi eux, une figure majeure : John Dewey. Dewey a été, au fond, le philosophe qui a accompagné aussi le sursaut rooseveltien. Il a un livre de 1933-1934 où il demande : « Est-ce qu’on croit à la démocratie ? » Il y développe une vision de la démocratie radicale : elle ne se réduit pas à l’élection. Elle correspond à un écosystème complexe — on revient à Glissant — fait de relations, de pouvoirs et de contre-pouvoirs, d’autonomie des acteurs ; et non de verticalité, ni d’ordonnancement autour d’une seule verticalité.
C’est très intéressant à revisiter. John Dewey, c’est aussi lui qui préside la commission — acte historique, quels que soient ensuite les bilans des courants — sur les procès de Moscou. Cette commission ne se contente pas de “blanchir” Trotski : elle met en lumière que les procès de Moscou, c’est l’extermination de toute une génération bolchevique. Dewey préside cette commission en démocrate libéral, et il dit à Trotski : « J’accepte, mais je garde mon autonomie de pensée. »
De là naît un débat entre eux, autour d’un texte : « Leur morale et la nôtre ». Est-ce que la fin justifie les moyens ? Trotski est embarrassé, parce qu’il a lui-même utilisé des moyens déterminés par les fins. Mais il voit aussi que le stalinisme pousse la logique jusqu’au bout : la fin justifie tous les moyens.
Son texte est donc dans une tension — que l’ancien libertaire Victor Serge lui reprochera. Et Dewey répond à Trotski de façon très éclairante : il montre comment — et on est au cœur de notre sujet, et de tous les égarements possibles, à gauche réformiste comme à gauche radicale — lorsqu’on commence à se dire que la fin justifie les moyens, on oublie que ce sont les moyens qui font les fins, les moyens qui déterminent les fins.
Cela peut être long, cela peut prendre du temps, cela peut passer par des défaites, sans raccourcis. Mais, comme disait Victor Serge : « de défaite en défaite, jusqu’à la victoire finale ».
Patrice Leclerc : Il y a une question de François Barthélémi, Edwy : si vous aviez trois priorités concrètes, pour faire reculer la vague brune en France dans l’année qui vient, ce serait quoi ? On va prendre des notes.
Edwy Plénel : Non. Moi, je suis désolé : je n’en ai qu’une.
C’est bien de consolider notre citadelle. Et la preuve — je dis souvent que Mediapart est un laboratoire —, c’est que nous avons créé Mediapart avec une intuition : nous venions de vivre un moment de recul, y compris à travers les crises de deux symboles de la presse indépendante, Le Monde et Libération.
On peut parler du succès de Mediapart, bien sûr. Mais il y a autre chose : l’équipe annoncera les résultats en mars prochain. Mediapart est non seulement structurellement rentable, mais c’est le seul journal réellement rentable en France, sans aucune aide. Et c’est devenu, en moins de deux décennies, le troisième quotidien par l’abonnement numérique, derrière Le Monde et Le Figaro.
Comment expliquer cela ? Par un journal construit dans l’univers du lien : le lien numérique, le lien créé par un journalisme d’impact. Je dis souvent : le virtuel, c’est du réel. C’est pour cela qu’on fait des réunions publiques. C’est pour cela qu’on a fait le film. C’est pour cela qu’on a fait ce film sur Sarkozy : ça a été le plus gros crowdfunding — enfin, pour le dire en bon français, financement participatif — de toute l’histoire du cinéma français.
Donc il y a une disponibilité. Et ce que montre le “laboratoire Mediapart”, c’est une disponibilité de la société, une demande de culture démocratique. Un bon journal, c’est aussi celui qui te bouscule, qui t’oblige à voir des choses que tu n’as pas envie de voir.
Chaque fois qu’on fait des révélations sur telle ou telle formation de gauche — et notamment quand c’est les plus sectaires —, on a des campagnes “désabonnez-vous”, etc. Mais ils ne se désabonnent pas : ils ont besoin de ce journal. Ils le lisent. Et il s’y passe des choses : on y apprend des choses. C’est une forme d’université populaire. Donc c’est la démonstration que c’est possible.
Ma tristesse, c’est que nous nous sommes dit : on va pouvoir “transformer l’essai” en 2012. N’oublions pas le rôle que nous avons joué avant l’élection de François Hollande — et Dieu sait si Nicolas Sarkozy nous en veut.
Mais c’est aussi nous — avec Édouard Glissant d’ailleurs, qui a tout de suite compris ce que signifiait le ministère de “l’Identité nationale et de l’Immigration” — qui avons montré comment cela brisait une digue qui a existé après-guerre. Une digue communiste / gaulliste, qui obligeait la droite qui était pétainiste à se convertir à des idéaux démocratiques qu’elle rejetait.
Il y avait donc une digue. Sarkozy brise cela. Quand il associe immigration et identité nationale, il ouvre une brèche dans l’égalité par le levier du bouc émissaire — l’étranger, l’immigré. Il ouvre la brèche. Et ensuite, dans le contexte de l’affaire Bettencourt, il fait son discours sur les Roms. C’est là que je le qualifie, dans un éditorial, de “délinquant constitutionnel”. Je rappelle ce que dit notre Constitution depuis 1946.
Et quand il reprend, comme vous le savez, des thèmes comme la préférence nationale, la déchéance de nationalité, il reprend les arguments de l’extrême droite. Le cauchemar, c’est que, dans un moment présenté comme de l’habileté politicienne, on a vu François Hollande, avec son Premier ministre Manuel Valls, reprendre cela au lendemain des attentats de novembre 2015. Cela a créé une blessure — et elle venait après tant d’autres.
Et encore une fois : tout était écrit en 2012. Le débat sur l’Europe. Le débat sur les paradis fiscaux. Le débat sur l’évasion fiscale. C’est pour cela que nous avons fait l’affaire Cahuzac comme cas d’école, pour démontrer ces questions. Le débat sur l’indépendance de la justice.
Je ne vous l’ai pas dit tout à l’heure, mais parmi les questions en jachère depuis quatre décennies, à gauche, il y a celle-là : l’indépendance de la justice. Meloni, aujourd’hui, en Italie, s’attaque à un des piliers de la République italienne. En Italie, les magistrats du siège (les juges) et les magistrats du parquet (les procureurs) appartiennent au même corps : cela signifie que les procureurs sont indépendants. C’est un socle de la République italienne après la défaite du fascisme. C’est ce qui a permis de démasquer la pieuvre mafieuse au cœur de la société italienne : les procureurs ont pu enquêter jusqu’en haut, jusqu’à la “mafia d’en haut”, sans avoir à informer le pouvoir exécutif.
Le symbole, c’est Roberto Scarpinato, survivant après les assassinats de Falcone et Borsellino, aujourd’hui sénateur de la République italienne. Ils ont pu montrer ce que nous savons en France, mais dont nous n’apercevons qu’un fragment — par exemple au moment du procès Sarkozy : l’ampleur de la haute criminalité politico-financière, qui finit forcément, à ce niveau, par s’articuler à une criminalité non politique. Roberto Saviano le raconte très bien : les flux financiers sont là.
Que se passe-t-il aujourd’hui en Italie ? Meloni a compris. Elle vient de Berlusconi, mais malgré tout, certaines résistances tenaient encore. Or elle veut changer ce socle : elle veut modifier le mode de recrutement des procureurs, et elle a déjà fait voter des dispositions. C’est une bataille qui se joue maintenant.
Et en France, comme vous le savez, aucune force politique de gauche — notamment ni le Parti socialiste, ni La France insoumise, je ne sais pas pour le Parti communiste — ne propose l’indépendance du parquet.
Dans un pays où la Constitution dit encore que la justice est une “autorité” judiciaire, et non un “pouvoir”. L’indépendance des procureurs ne repose aujourd’hui que sur leurs qualités personnelles, ou sur des rapports de force construits — modestement, grâce à nos révélations — qui déclenchent le parquet financier, ou provoquent des mouvements comme ceux liés aux violences sexistes et sexuelles, où la justice se met en branle. Mais cela reste très faible comme moyens. Treize ans d’enquête sur Sarkozy : un seul policier tout du long. Bien sûr, d’autres se sont ajoutés ponctuellement, mais sur le même dossier, pendant une décennie : un seul policier — le commandant Vidal.
Je dis cela pour montrer combien l’occasion manquée de 2012-2017 — et ce qui a produit ensuite le macronisme, qui a su en jouer — est terrible. Tout était diagnostiqué : la crise grecque, les droits fondamentaux, la tentation de l’absolu policier (déjà à l’œuvre quand Sarkozy était ministre de l’Intérieur), la question de l’éthique et de la morale, et, au fond, l’idéal démocratique et social de la République.
Tout était sur la table. Et voilà. À un moment, il faut payer le prix de tout cela. Mais aujourd’hui, il faut en tirer les leçons. Je suis un peu le Cassandre mais je pense qu’il faut accepter de regarder ce qu’on a raté, apprendre de nos erreurs — sans se juger les uns les autres —, et surtout ne pas les reproduire.
Et je reviens à Mediapart : si Mediapart est une réussite, c’est qu’il répond à une demande sociale. Il est en écho avec une demande sociale. Donc cette demande sociale est disponible pour celles et ceux qui veulent agir dans la société.
Voilà. Moi, c’est « agis en ton lieu » : je ne peux pas vous donner trois priorités. À vous de les inventer. Mais nous, nous avons essayé de montrer que c’était possible — et possible sans raccourci.
Je vais faire un peu de mauvais humour : sans dirigeant fondateur accroché au pouvoir, avec une capacité d’organiser la transmission, de faire surgir de nouvelles générations.
Voilà : il faut faire ça aussi en politique.
Patrice Leclerc : Tu as tu as parlé justice donc tu as réveillé l’avocat qui nous écoutait. Patrice Cohen-Seat a levé la main…
Patrice Cohen-Seat : Je te signale qu’en 2000, quand j’étais encore dirigeant national du Parti communiste, j’avais fait adopter par le Conseil national un document qui s’appelait Pour une démocratisation permanente de la République. Parmi les propositions, il y avait l’indépendance du parquet, comme une clé.
Cela dit, je ne vais pas te rassurer : le Parti communiste, en lui-même, n’en a rien fait — et c’est symptomatique.
Mais ma question porte sur autre chose. Tu disais tout à l’heure, à propos de Sarkozy, qu’il avait « ouvert la brèche ». Or, si Sarkozy a ouvert la brèche, il faut bien admettre que beaucoup d’autres dirigeants, dans presque toutes les démocraties libérales, ont ouvert aussi la brèche. Dans toutes les démocraties libérales — jusqu’à des pays qu’on situe à nos confins comme la Corée du Sud ou le Japon — l’extrême droite monte, et la gauche est dans les choux.
Donc je me dis : oui, il y a la responsabilité personnelle, parce que l’histoire se fait par l’action des uns et des autres. Mais il y a aussi un mouvement d’ensemble : quelque chose de très profond est en train de se passer, qui fait monter l’extrême droite et met la gauche en difficulté.
En même temps, je partage ton constat : il y a une disponibilité énorme dans la société — en tout cas, dans la société française, que je connais mieux. Oui, je crois qu’il y a une grande disponibilité.
Et donc j’en viens à ce diagnostic : la responsabilité appartient à la gauche. C’est dans son incapacité à réagir à l’effondrement du rêve socialiste — du socialisme étatique — et à inventer un nouvel horizon, un nouvel imaginaire, que se situe le problème. Qu’en dis-tu ?
Edwy Plénel : Je suis totalement d’accord. Je l’ai dit un peu au début : quand je parle de « capitalisme du désastre », je dis aussi que ces idéologies de l’inégalité naturelle — qui, pour moi, définissent l’extrême droite sous tous ses visages, avec plus ou moins d’intensité — étaient en réserve, du côté de la réaction et du conservatisme.
Et plus ces milieux se sentent en péril — parce qu’au fond, ils se sentent en péril, ils se savent profondément minoritaires —, plus ils se radicalisent. Ils sont dans une logique court-termiste. De ce point de vue, on ne connaît pas la fin du film, mais leur raisonnement est un raisonnement de prédation : à l’échelle d’une vie humaine, d’une succession, d’un héritage.
Le cas russe est très intéressant. Tous les spécialistes de l’oligarchie poutinienne montrent qu’il s’agit d’une bande mafieuse qui a mis la main, en éliminant ses rivaux, sur les richesses — notamment les énergies fossiles — pour faire sa fortune. Et, au fond, la guerre est pour elle un moyen de survie. Pourquoi ? Parce que la société bouge. La Russie bougeait, comme l’Ukraine bougeait. Et on le voit dans des symboles : juste avant l’invasion de l’Ukraine, Poutine met fin à Memorial, il criminalise Memorial à la fin 2021 — Memorial, c’est ce que la société civile avait construit pour documenter les crimes du stalinisme.
Et cela a été moins remarqué, mais il a aussi dissous le Comité Helsinki. Vous qui êtes de vieux militants, vous vous en souvenez : le Comité Helsinki, c’est ce moment des années 1970 où, malgré les deux blocs, des idéaux démocratiques avancent, avec lesquels on est obligé de composer — Sakharov, etc. Tout cela a été rayé.
Pourquoi ? Parce qu’il faut “mithridatiser” la société : ils ont besoin que les sociétés ne puissent plus leur demander des comptes, qu’elles ne soient plus auto-organisées, qu’elles ne soient plus disponibles.
Donc oui : la gauche a une responsabilité, parce que l’idéal visé, c’est celui qu’elle a porté. Elle a porté l’idéal d’égalité naturelle. Elle a porté les conquêtes démocratiques, qui incluent les conquêtes sociales, les droits des minorités, et ainsi de suite.
Cette question rassembleuse — ce que j’appelle les “causes communes” de l’égalité — nous remet presque dans une situation qui rappelle les combats fondateurs du XIXe siècle. On est au cœur du socle de ce qui a fondé notre histoire commune.
Et c’est le fait de ne pas avoir pris conscience de l’urgence, de la tragédie, de la catastrophe, qui explique cela : ne pas avoir tiré les leçons. On le voit aussi dans la fascination qui existe encore, dans certaines gauches, pour des pouvoirs autoritaires. On peut être totalement au rendez-vous de la cause palestinienne sans jamais céder à la complaisance envers un prétendu « axe de la résistance » qui irait des mollahs de Téhéran à la dictature de Bachar el-Assad, en passant par le Hezbollah et l’idéologie du Hamas. Cet « axe de la résistance », c’est le meilleur cadeau à faire à Netanyahou et aux autres : ce sont des pouvoirs et des idéologies ennemis de leur propre peuple.
C’est cela, la dureté du moment : tenir debout, être solidaires des peuples qui résistent, et en même temps ne pas réduire la lutte des peuples à des logiques étatiques, à des logiques de domination qui veulent la confisquer.
Je pense que la société est disponible pour entendre cela. Mais le mouvement commun qui pourrait porter cette parole… c’est là qu’il y a un problème. C’est pour cela que je revisite le quinquennat Hollande : il a donné des ailes à toutes les divisions au sein des gauches, et donc à la logique hégémonique que La France insoumise a conquise ces dernières années — après avoir utilisé le Parti communiste comme marchepied dans une première étape.
Je reviens là-dessus parce qu’il faut se défaire d’illusions. Moi-même, j’ai eu des illusions : je suis allé à Moscou après la chute du Mur, mais avant la fin de l’Union soviétique. J’avais dirigé une collection à l’époque, et j’y ai publié les mémoires de la veuve de Boukharine, Anna Larina Boukharina, qui avait appris par cœur le testament de Boukharine. Je suis allé à Moscou — il y avait encore les Éditions du Progrès, tout ça (je parle comme un vieux, mais enfin… on n’est plus tout jeunes).
Pourquoi je dis ça ? Parce que je pensais qu’après Chalamov, après tout ce qu’on avait lu — et on n’avait pas attendu Soljenitsyne, même s’il a évidemment eu un rôle —, on découvrirait plein de textes, plein de surprises, plein de choses sorties des tiroirs. Eh bien non : il n’y avait pas grand-chose. Il y avait ce que pouvait faire la société civile, Memorial : aller chercher les tombes, les traces, les documents. Mais soixante-dix ans, ça pèse. Ça pèse sur l’histoire d’une société, sur la violence en son sein — et toutes les spécialistes le documentent.
De ce point de vue, ce que nous raconte l’Ukraine est très important : tout à coup, un peuple issu de cette histoire — avec des dirigeants soviétiques qui en venaient aussi, Khrouchtchev, Trotsky, et beaucoup d’autres — se met en branle. C’est cela, Maïdan : un peuple qui se met en mouvement.
Bien sûr, il y a une extrême droite ; bien sûr, il y a des manœuvres de puissances. Mais il y a d’abord un peuple qui s’autodétermine, qui fait son chemin. Et il nous faut toujours apprendre des peuples, regarder ce qu’ils font.
Donc oui : je suis entièrement d’accord. Mais je pense que ça ne sert à rien de se lamenter. Je le redis : « agis en ton lieu et pense avec le monde ». Vous le faites à Gennevilliers, dans une campagne municipale. D’autres le font là où ils habitent, là où ils vivent.
Reste qu’il y a une déconnexion entre cette réalité, et sa traduction partisane, qui reste ordonnée à une logique verticale.
Pour moi l’épisode de l’été 2024 en est un exemple : nous pourrions être aujourd’hui avec des comités du NFP partout en France, où les gens auraient appris à se parler ; où des gens qui ne venaient plus seraient revenus ; où ils auraient appris à se connaître, à être unitaires, au lieu d’être dans la compétition et le sectarisme.
Voilà.
Leïla Cukierman : Merci, Edwy. C’était bien de rappeler que les comités du NFP — enfin, la société — ont fait barrage en 2024. Ça nous a donné un élan d’espoir, qui s’est ensuite un peu étiolé.
J’ai une dernière question, parce qu’il faut qu’on finisse : comment analyser le positionnement assez faible du Rassemblement national sur le Venezuela ? Il n’est pas dans une condamnation absolue de Trump.
Edwy Plénel : Je pense qu’il ne faut surtout pas sous-estimer l’intelligence du Rassemblement national et de ses dirigeants.
Je dis souvent : mon premier livre — j’avais 32 ans — s’appelait L’Effet Le Pen. C’était en 1984. À l’époque, beaucoup de gens à gauche disaient : « C’est comme le poujadisme », en voyant le surgissement électoral — vous vous en souvenez : d’abord à Dreux, puis aux élections européennes.
Moi, j’avais écrit ce livre à partir de ce qu’on publiait au Monde pour dire : non, Le Pen a un futur parce qu’il a un passé. Et pour revisiter ce que nous savons : Vichy, l’histoire de la droite française jusqu’à la Seconde Guerre mondiale — ce que Paxton, puis Sternhell et d’autres ont énormément documenté —, et ce “miracle gaulliste” qui a obligé cette droite, provisoirement, à se convertir à une autre histoire.
Ensuite, il y a la guerre d’Algérie, la question coloniale… et des éléments qui, à l’époque, étaient encore dans les placards du président François Mitterrand : on n’avait pas encore les révélations sur Mitterrand et Vichy, et on avait un peu oublié Mitterrand et la guerre d’Algérie.
J’ai fait ce livre en documentant aussi les réseaux intellectuels : j’ai beaucoup écrit sur la “Nouvelle Droite”.
Par exemple, aujourd’hui, on parle beaucoup de Carl Schmitt — celui qui théorise, au fond, le coup de force, l’état d’exception — et qui est très lu par des conseillers de Trump. Juriste brillant, il a aussi été un juriste du nazisme. Il théorise l’idée qu’une chose compte : qui est le maître. Si je suis le maître, je peux tout, y compris décréter que je suis le maître. C’est une pensée du pouvoir absolu.
Or Carl Schmitt était déjà très lu, commenté, recyclé par la Nouvelle Droite. Eux ont pris le temps. Et nous, la gauche — je ne parle pas de moi, mais globalement — nous sommes restés dans une forme de bulle, en mettant tout cela de côté comme si c’était anecdotique, alors qu’ils travaillaient.
On l’a oublié, mais dans les années 1990, il y a eu par exemple ce Parti national-bolchevique autour d’Édouard Limonov, avec Alexandre Douguine, qui était déjà une passerelle avec certains réseaux de la Nouvelle Droite, ceux d’Alain de Benoist et d’autres.
Aujourd’hui, on voit leurs réseaux, et on voit l’argent des milliardaires qui les finance. Mais ces réseaux existaient déjà.
Il y a une figure, que j’ai essayé de mettre en lumière parce que peu de gens s’en emparaient : un conseiller de Netanyahou, qui l’a aidé à se maintenir au pouvoir ; un conseiller d’Orban ; et un acteur central des réseaux “nationalistes conservateurs” américains. Il s’appelle Yoram Hazony, américano-israélien.
C’est lui qui a écrit une sorte de bible : Les Vertus du nationalisme, dont l’édition française est préfacée par Gilles-William Goldnadel, publiciste d’extrême droite qu’on voit sur les plateaux de CNews. C’est un livre d’intellectuel, qui théorise une vision à la Joseph de Maistre : on met à bat Jean-Jacques Rousseau, on renverse l’idée d’une humanité commune, toute vision internationaliste, toute logique de relation. Ne comptent plus que ma nation, mon peuple, mon identité. Et ensuite, on fait des “deals”.
D’où ces arrangements permanents : Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Turquie… On s’arrange. Nous ne les avons pas assez lus, pas assez regardés.
Et, pour en revenir au Rassemblement national : je vais peut-être vous choquer, mais, à part le fait que c’est une boutique familiale, Le Pen — je parle de Jean-Marie Le Pen — n’a jamais “cédé” son pouvoir sur ce mouvement. Cela pose d’ailleurs des questions sur la relation entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, selon l’issue du procès en appel de Marine Le Pen : il y a une longue histoire de clan familial autour des Le Pen, avec les gendres, les amis, les cousins… Si un jour Marine Le Pen était présidente, ce serait un peu comme si les Bonaparte arrivaient au cœur du pouvoir.
Mais ce que je veux dire, c’est ceci : Jean-Marie Le Pen a pu faire toutes les carambouilles qu’il voulait, il n’a jamais été “à la soupe”. Le Pen est un adversaire — mais c’est un militant. Bruno Mégret, lui, a été tenté d’aller à la soupe. D’autres dissidents ont été tentés d’y aller. Le Pen, lui, est resté maître de sa boutique, de son clan — avec des tensions, certes — mais fidèle, d’une certaine manière, à une histoire militante.
Et cela doit nous interroger : des parcours de constance « de l’autre côté », comme la constance intellectuelle d’Alain de Benoist, avec ses ruses, ses stratégies d’habillage pour “rebanaliser” — c’est ce que j’ai analysé dans L’Appel à la vigilance. Maurice Olender avait déjà démasqué cela en 1993 : banaliser des auteurs d’extrême droite, banaliser ce vieux fond radicalement réactionnaire, ces “révolutionnaires conservateurs”.
Ils ont eu cette stratégie aussi avec des figures intellectuelles. L’auteur cité au début de la préface de Goldnadel, c’est Pierre Boutang, professeur à la Sorbonne, qui a “sauvé” l’héritage de Maurras — en relativisant son antisémitisme tout en conservant l’architecture de sa pensée —, et qui était au cœur de la Sorbonne, à une époque où la gauche dominait les lieux universitaires.
Il a formé des héritiers de cette longue durée : de Joseph de Maistre — dont la statue est à Chambéry — à Maurras, à Carl Schmitt, jusqu’aux figures qu’on a devant nous aujourd’hui.Et comme dans toutes les époques de bascule, beaucoup passent du côté obscur : parce que c’est plus attractif, parce q ue le pouvoir est de ce côté-là, parce que l’argent est de ce côté-là, parce que la carrière est de ce côté-là.
Patrice Leclerc : Il y a un commentaire de Frank : « À quand une initiative forte et commune des sites d’info et journaux indépendants des forces de l’argent — certains anciens comme L’Humanité, d’autres plus récents comme Mediapart, et tout numériques comme Blast, Arrêt sur images, etc. — pour travailler à un front commun de l’information alternative ? »
Edwy Plénel : Ça, c’est déjà fait.
Le Fonds pour une presse libre que nous avons créé — une structure non lucrative, indépendante de Mediapart — s’en occupe. Il est présidé par François Bonnet. D’ailleurs, ils ont mené le “procès Bolloré”, qui va ressortir en livre prochainement.
Et c’est ce même réseau qui avait organisé les meetings dont j’ai parlé en 2024. Je rappelle au passage que l’équipe de la Fête de l’Humanité en a assuré l’intendance. Donc oui : bien sûr, on le fait, et on y travaille.
Mais — et je voudrais terminer là-dessus — l’absence de réforme structurelle crée une immense fragilité. Parce qu’un pouvoir d’extrême droite qui arriverait au pouvoir aujourd’hui disposerait de leviers exceptionnels sur les médias.
L’ARCOM a, au fond, abandonné l’affaire en matière de régulation : elle accepte l’idée qu’il y aurait des “médias d’opinion” sur des fréquences qui sont des biens publics. Et elle renonce ainsi à l’exigence de pluralisme interne, en installant une logique du type : « une radio d’extrême droite, une radio de gauche, une radio… », etc., pour la radio comme pour la télévision.
C’est une catastrophe. Parce que donner des médias de masse à des idéologies qui, pour certaines, relèvent de propos pénalement répréhensibles, c’est ouvrir la voie à un enfermement du débat public — avec des conséquences lourdes sur la vie démocratique. C’est ce que nous vivons avec l’ascension du groupe Bolloré et son influence, y compris sur le service public.
Et, s’agissant des médias indépendants, la question est très concrète : le principal mode d’intervention de l’État dans la presse, ce sont les aides publiques.
Mediapart — et je ne dis pas cela pour nous ériger en modèle — a réussi sans aides : nous ne touchons pas un centime d’argent public. Nous vivons uniquement des abonnements. Mais nous sommes une exception, et même une exception assez solitaire. Nous ne bénéficions que de l’aide indirecte qu’est la TVA super-réduite. Et on nous a fait payer cher cette bataille — gagnée finalement pour tout le monde —, et on nous l’a fait payer sous la gauche, hélas. Mais, en dehors de cela, nous n’avons rien.
En revanche, les aides publiques, captées d’abord par les milliardaires — Bernard Arnault et d’autres —, constituent un levier terrifiant. Si demain un pouvoir d’extrême droite arrive, il pourra utiliser ces aides comme moyen de pression sur quantité de médias.
D’où l’importance des fonds, des soutiens, des solidarités — qui existent et qui fonctionnent. Mais l’absence d’un travail de fond pour refonder vraiment un écosystème de l’information, nous la payons très cher aujourd’hui, dans la manière dont se déroule le débat public.
Et, au passage, coup de chapeau à L’Humanité : ces dernières années, l’Huma s’est vraiment dynamisée. Même en tant que presse traditionnelle, papier, je trouve qu’elle a grandement réussi son pari. On retrouve presque quelque chose de l’énergie de Libé d’il y a longtemps. L’Huma a vraiment réussi.
Voilà. Merci beaucoup.
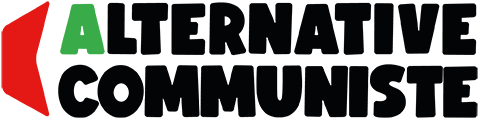



Laisser un commentaire